La
Fée Carabine, Daniel Pennac, 1987
|
||
| Deuxième volet d'une
série (d'aucuns parlent de "saga") commencée avec Au Bonheur des Ogres (1985),
achevée, au moins provisoirement, avec Terminus Malaussène (2
volumes,
2023). Les deux premiers romans sont d'abord publiés dans la série noire et,
de fait, ce sont en quelque sorte des romans policiers. Mais très vite,
Gallimard perçoit le potentiel de vente, et les romans vont s'afficher
dans ce qu'il est convenu d'appeler la "collection blanche", celle des
noms prestigieux, et très vite gagner leurs galons de livre de poche
dans la collection Folio où le lecteur, et tout autant la lectrice,
peut
tous les trouver. Le Monde diplomatique (décembre 1988) faisait état de 55 000 exemplaires vendus pour La Fée Carabine à cette date. L'année même de sa parution, il obtient le Trophée 813 du meilleur roman policier et, en 1988, Le prix Mystère de la critique. |

Daniel Pennac, 2023
|
L'écrivainIl est né Daniel Pennacchioni le 1er décembre 1944 à Casablanca (Maroc) où son père, officier, est en poste. Il est le petit dernier d'une fratrie de 4 garçons. Il passe son enfance au gré des mutations du père. Il assure dans Chagrin d'école (2007) avoir eu une scolarité désastreuse : "Donc, j'étais un mauvais élève" (Gallimard, 2007, p. 17). Ces débuts peu heureux ne l'empéchèrent cependant pas d'obtenir son baccalauréat et une maîtrise de Lettres. Comme il est logique dans ce type de parcours, Pennac devient professeur : un métier qu'il exerce de 1969 à 1995. Cette année-là, il décide de quitter l'enseignement pour "se consacrer à l'écriture", selon la sacro-sainte formule des histoires de la littératureIl change de nom (pour ne pas embarrasser son père, dit-il, en ajoutant lors d'une de ses interviews (France Culture, 4 janvier 2017) que la déclaration a bien fait rire le père qui lui a alors confié que tout le monde l'appelait "Pennac") à la publication d'un pamphlet contre l'armée (1973), écrit après son service militaire, Le Service miltiaire au service de qui ? Le titre est dû à l'éditeur, lui avait choisi "Tu seras un fils, mon homme", jeu bien sûr avec le vers de Kipling "Tu seras un homme mon fils". Entre 1979 et 1981, il séjourne au Brésil pour accompagner sa première épouse, professeur de sociologie, recrutée par l'Université Fédérale du Ceará. A son retour, il commence à écrire des récits pour les enfants (Cabot-Caboche, L'Oeil du loup), avant d'être, dit-il, mis au défi, par Jean-Bernard Pouy, d'écrire un roman policier, dans le style "néo-polar" qu'il défendait avec ses amis et complices comme Patrick Raynal. Le résultat sera Au Bonheur des Ogres. D'emblée, un énorme succès. Que conforteront les suivants. Entrée en littérature que Pennac va développer sur tous les tons : les romans, dont le plus surprenant reste Journal d'un corps (2012), les livres pour les enfants, le théâtre, les enregistrements pour les livres, car l'auteur a le goût du partage oral, les essais dont nous retiendront en particulier, Comme un roman (1992), des bandes dessinées. Il y a peu à dire d'autre. Il faut lire ses livres parce que ce sont des livres qui ont cet extraordinaire pouvoir d'ouvrir les chemins de la lecture à ceux qui s'en détournaient. |
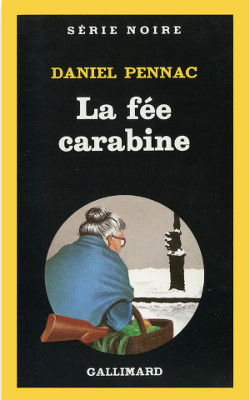 La Fée carabine, première de couverture, série noire 1987. Illustration de Richard Martens |
Le romanIl suit à peu près les codes du roman policier en commençant par un meurtre. Particularité, toutefois, l'assassin est une vieille dame, la victime un jeune policier un peu raciste. L'événement se déroule un jour d'hiver, à Belleville, et les témoins n'ont, naturellement, rien vu, d'où enquête. Il se continue en mettant à jour deux intrigues policières : la découverte d'un trafic de drogues visant les vieilles personnes (interrogation : pourquoi les vieux ? comment ? qui ?) et un tueur au rasoir qui attaque les vielles femmes (au début du récit quatre meurtres ont déjà été perpétrés), sans mystère, puisque c'est pour les voler.L'ensemble se déploie sur 39 chapitres répartis en quatre parties; I. La ville, une nuit, 9 chapitres (1-9) ; II. Le bouc, 15 chapitres (10-25) ; III. Pastor, 10 chapitres (16-35) ; IV. La Fée carabine, 4 chapitres (36-39). La dernière partie fonctionnant pour une large part comme un épilogue où le dernier chapitre reprend le premier raconté par l'un des personnages : "C'était l'hiver sur Belleville, et il y avait cinq personnages. Six en comptant la plaque de verglas. Sept, même avec le chien..." Car les personnages sont essentiels dans les romans de Pennac. La "tribu" Maluassène Elle apparaissait déjà dans Au Bonheur des Ogres. Elle est composée de : Benjamin Malaussène, aîné de la famille, se disant lui-même "Frère de famille", autant dire celui qui fournit aux dépenses. Occupe un travail qui peut changer de titre selon les employeurs mais qui consiste à se faire "engueuler" par les mécontents au point de les convaincre de le plaindre plutôt que de se plaindre. Benjamin se dit "bouc émissaire" (et Pennac ne cache pas sa dette à l'égard des analyses de René Girard, en particulier dans Le Bouc émissaire publié en 1982). Personnage plutôt replié sur lui-même, ne se préoccupe guère du monde extérieur quoique celui-ci aurait tendance à s'occuper beaucoup de lui. Doit approcher la trentaine. Il est le narrateur de l'histoire. Louna : infirmière, mariée à Laurent, médecin. Le couple a des jumelles, mais ne vit pas avec la famille. Clara : en âge de passer le bac (16 ans dit le narrateur). "Voix de velours". Photographe née. Ce n'est qu'à travers l'obturateur d'une appareil photographique qu'elle arrive à rendre supportable le monde. Cuisinière attitrée (et douée) de la tribu. Benjamin a un rapport particulier avec Clara l'ayant accouchée pour cause de sage-femme ivre. Thérèse : Dans Au Bonheur des ogres paraissait plus jeune que Clara, ici c'est moins évident : "raide comme le Savoir. Elle a la peau sèche, un long corps osseux, et la voix pédagogique. C'est le degré zéro du charme." Mais c'est une sorcière qui met toute l'astrologie au service de la résurrection de ceux qui ont perdu le goût de vivre. Jérémy : 12 ans, peu porté sur l'école (il redouble sa cinquième) mais curieux, entreprenant (avait mis le feu à son collège en fabriquant une bombe dans Au Bonheur des ogres). Le petit : cinq ans, des lunettes roses. A l'âge où tout se transforme en conte. |
|||
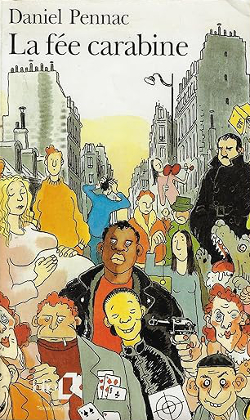 première de couverture, Tardi, Folio, 1995, où le dessinateur fait place à la variété du monde de Belleville. |
La mère : enceinte, attendant l'heure de
l'accouchement. En est à son septième enfant (tous de pères inconnus). A
pour particularité de disparaître ensuite avec un nouvel amour.
Laissant sa progéniture aux soins de Benjamin ("un bon fils"). Julius : chien épileptique. La famille se complète de Julie Corrençon, grand amour de Benjamin, journaliste pigiste pour Actuel. Lancée dans ce roman sur les traces des vendeurs de drogues aux vieillards, dont elle a tiré quatre grand-pères confiés à la famille : Papy-Rognon, ancien boucher à Tlemcen, confié à Clara (cuisine oblige) ; Risson, ancien libraire, confié à Jérémy ; Papy-Merlan, ancien coiffeur, s'occupe de la chevelure de la mère ; Papy-Verdun, ancien combattant de 14x18 confié au Petit. Enfin, Semelle, ancien cordonnier de la rue voisine qui n'habite pas avec la famille, mais en est le protégé, "action préventive" dit Benjamin. Enfin, l'ami Stojilkovicz (dit Stojil), Serbo-croate, ex-séminariste, "ex-révolutionnaire, ex-vainqueur des armées Vlassov et de l'hydre nazie", ami de Benjamin et son partenaire aux échecs. Chauffeur de bus pour touristes. A une voix bien particulière qui "ressemble à Big Ben dans le brouillard d'un film londonien". La police Puisqu'il s'agit d'un roman policier, il nécessite une équipe de policiers. Deux équipes, en fait, aux comportements et aux valeurs totalement opposées. D'un côté, Coudrier, homme discret, réfléchi, avec qui travaillent Jean-Baptiste Pastor et Van Thian, "l'inspecteur Van Thian était un flic maigre, vieux et chroniquement déprimé" ; a pour particularité la voix de Gabin. Agit sous le déguisement de la "veuve Hô", ce qui a tendance à le pousser à la schizophrénie. Fait aussi plus ou moins partie de l'équipe, Carrega "un râblé à nuque de taureau, vêtu en toutes saisons du même blouson d'aviateur à col fourré", un gentil, amoureux d'une esthéticienne. De l'autre, Cercaire, "patron" des stupéfiants, caricature de flic à manteau de cuir, grande gueule, raciste, et corrompu... Ses suborndonnés n'ont, comme on s'en doute, aucune existence, ombres furtives vouées à l'obéissance. Quelques autres : La reine Zabo, patronne de Malaussène aux éditions du Talion où il porte le titre pompeux de "directeur littéraire". Hadouch Ben Tayeb, copain de Benjamin, fils d'Amar et de Yasmina qui ont aussi servi de parents de substitution à Benjamin. Hadouch, avec ses lieutenants Simon le Kabyle (sent la menthe) et Mo le Mossi (sent la canelle) contrôlent les loteries clandestines de Belleville. Marginaux sympathiques. Marty : le médecin préféré de la famille malaussène depuis qu'il a recousu le doigt coupé de Jérémy (Au Bonheur des Ogres). Les vrais vilains : L'architecte Ponthard-Delmaire, obèse, arrogant, s'enrichit dans la restructuration du quartier. A une fille, Edith, qui fait dans le trafic de drogue. Arnaud Le Capelier, Secrétaire d'Etat aux personnes âgées, qui les déteste comme on pouvait s'y attendre. |
|||
Au plaisir de lirePennac raconte des histoires à tous les sens du terme, celui péjoratif qui voit dans les "histoires" des mensonges plus ou moins séduisants, celui neutre du récit d'une succession d'événements. Et les événements se succèdent dans ce récit, entraînant leurs lots de surprises, de rebondissements, à la limite du vraisemblable, souvent, mais qui se soucie du vraisemblable quand l'histoire est bien racontée. Et celle-là l'est, d'abord parce que ces histoires arrivent à des personnages que le lecteur prend immédiatement en sympathie pour la raison qu'à l'exception des "vilains-vilains" peu nombreux, et "bêtes" dans leur certitude de pouvoir manipuler autrui, tous les autres (même les "coléreux" par vocation comme Van Thian) sont profondément bons et généreux. Leurs aventures, quelquefois effrayantes, souvent burlesques aussi, conduisent le lecteur dans un monde de l'échange, du partage, où se côtoient toutes les nationalités, toutes les origines, tous les âges, dont le mélange fait la saveur du monde. Et ce d'autant plus que le narrateur intègre dans son récit les divers passés des uns et des autres, donnant à chacun une densité rare dans ce genre de romans.De plus la langue du narrateur est elle-même un "mélange" bien dosé de langage familier (avec quelques pincées d'argot, mais pas tant que cela), de langage soutenu (parfois jusquà la sophistication), de jeux avec les mots, comme toujours porteurs de dénonciation, par exemple le "chaud Bisenesse" (francisation du terme proche de Queneau qui dit en même temps qu'il se joue la sexualité implicite à l'univers du spectacle). Cette langue, très proche en apparence de celle des lecteurs facilite ainsi l'entrée dans un univers qui, outre ses dimensions ludiques (après tout il s'agit toujours de dévoiler des mystères : pourquoi droguer des vieiilards ? Qui est le tueur des vieilles dames ?), s'ouvre aussi sur les interrogations sociales : que fait la société des vieilles personnes ? Qu'est-ce que les normes sociales prétendant "encarter" les uns et les autres et dont le flic Cercaire est l'innénarable garant 'du moins le croit-il) Réflexions des personnages ou réflexions du narrateur font du roman une manière de conversation avec celui/celle qui le lit, comme le récit lui-même joue avec les références littéraires qu'il s'agisse de la littérature policière comme de la dite "grande littérature" toujours avec un humour qui en désamorce le sérieux. La Fée Carabine est un jeu qui éveille tous les sourires. Et quand on a fini ? On peut lire les autres ou relire celui-là. Le plaisir est sans fin. |
||||
A Ecouter : la série des cinq "A voix nue" que consacre France Culture à Pennac en janvier 2017. |