27 juin 1908 : João Guimarães Rosa
|
||
 João Guimarães Rosa, 1943
|
Un écrivainConsidéré dans son pays, le Brésil, comme le plus grand de ses écrivains, Guimarães Rosa est peu connu en France. Ecrivain étonnant, il a inventé une oeuvre toute sienne, irriguée de ses multiples expériences de vie, mais aussi de toutes ses passions nombreuses, pour les langues, en général, et la sienne, en particulier, pour la faune, pour la flore, pour les littératures, autant populaires que savantes, attentif aux contes des paysans de sa terre natale tout autant qu'aux textes classiques, lus crayon en main, de Homère à Proust en passant par Dante, ou Graham Greene, de préférence dans le texte. En 1966, il confiait à une jeune cousine qui l'avait interrogé : "Je parle : portugais, allemand, français, espagnol, italien, espéranto, un peu russe; je lis : le suédois, le hollandais, le latin et le grec (mais accroché au dictionnaire)" et d'ajouter qu'il avait étudié la grammaire de quelques autres langues, car "Je pense qu'étudier l'esprit et le mécanisme des autres langues aide beaucoup à une compréhension plus profonde de l'idiome national. Avant tout, néanmoins, je les étudie par amusement, goût, distraction."Qui était donc Guimarães Rosa ? Il est né à Cordisburgo (dont le premier nom avait été Vista Alegre), petite ville de l'état du Minas Gerais, le 27 juin 1908, et mort à Rio de Janeiro, d'une crise cardiaque, le 19 novembre 1967, alors que la ville avait cessé d'être la capitale du Brésil en 1960, transférée à Brasilia, nouvellement construite. Un parcours de vie dense et relativement bref dans lequel il est possible de distinguer trois dimensions qui sans doute expliquent la complexité de l'écrivain. Entre 1908 et 1934, domine l'univers du Minas Gerais. Il est le premier des sept enfants de sa famille, le père tient une sorte de bazar en face de la gare; il grandit dans son village, dont les écrits, bien plus tard, transmettront le souvenir enchanté et l'un de ses personnages confiera : "C'était un endroit tout en beauté, en raison de son air et de son ciel et de la composition que Dieu avait soignée entre mornes et vallées ; et pour cela même, là, d'abord, ça s'était appelé "Vista Alegra" [Vue heureuse]... Ah! et les étoiles de Cordisburgo, aussi... c'était celles qui brillaient, peut-être dans le monde entier, avec le plus d'élan joyeux ." (O Recado do Morro in Corpo de baile). |
|||
| A six ans, il est envoyé chez
ses grands parents, à Belo Horizonte
(capitale de l'état), où il fera toutes ses études, y compris
universitaires, puisqu'il entre à l'école de médecine en 1925 d'où il
sortira diplômé en 1930. Au cours de ses années de
médecine, il noue une amitié avec un condisciple, un peu plus âgé, Juscelino Kubitscheck, qui poursuivra une carrière
politique en devenant d'abord maire de Belo Horizonte, puis président
de la République, en 1956. Le voilà donc médecin, en 1930. Il commence sa carrière à Itaguara, où il déménage avec son épouse. Il s'est marié en 1930 avec Lygia Cabral Penna. Le couple aura deux enfants (Vilma, née en 1931 et Agnès, née en 1934). Après un concours, en 1933, il devient médecin militaire et prend son poste à Barbacena. Il a fait ses premiers pas d'écrivain en gagnant un concours de nouvelles organisé par le journal O Cruzeiro. Le conte, O Mistério de Highmore Hall, est publié en juillet 1929. Trois autres suivront en 1930. De son vivant, l'écrivain n'en a jamais accepté la reprise. Et d'affirmer, en expliquant son parcours que, si depuis toujours il invente des histoires, il n'a vraiment commencé à écrire qu'en 1929, "quelques contes, qui, naturellement, ne valent rien." (Lettre à Lenice, 19 janvier 1966) |
||||
|
Le palais Itamaraty, Rio de Janeiro, siège du ministère des Relations extérieures avant son transfert à Brasilia où il conservera son nom. |
1934-1967, le
diplomate-écrivain. Mais la médecine, comme il le dit lui-même, l'écrivant à un ami, en mars 1934, n'est pas vraiment ce qui lui convient "je ne peux agir avec satisfaction que sur le terrain des théories, des textes, du pur raisonnement, des subjectivismes". Il va préparer et passer le concours d'entrée dans la diplomatie, et il est admis et nommé, dans la Carrière, en juillet 1934. Il déménage alors, avec sa famille, pour Rio de Janeiro d'où il confie à son ami Pedro Barbosa : "Je pense que j'ai rencontré à temps ma véritable vocation. J'ai l'intention de suivre un cours de Droit, me spécialiser en Droit international et en langues slaves, écrire quelques livres de littérature et voir le monde là-bas." (Lettre du 13 août 1934) Trente ans plus tard, en 1964, c'est cette même raison qu'il reprend pour expliquer à son traducteur italien son changement d'orientation, "le fervent désir de voyager par le monde" ("a ânsia de viajar mundo"). Quatre années vont s'écouler en attendant de réaliser tous ces projets. Pour l'heure, il travaille au secrétariat du ministère et écrit. En 1936, il propose un recueil de poèmes au Concours littéraire organisé par l'Académie brésilienne des Lettres, Magma, concours qu'il gagne (sous le nom de Viator, latin pour "Voyageur") mais le livre ne sera publié que dix ans après sa mort. Il semble s'en être tout à fait désintéressé. Pourtant, sur le moment, la satisfaction le pousse à proposer 12 contes (toujours sous le nom de Viator) au Prix Humberto de Campos décerné par l'éditeur José Olympio. Il n'obtiendra que le deuxième prix mais la littérature y gagne sans doute, car cela lui donnera l'occasion de retravailler ce qui finira par devenir, amputé toutefois de trois textes, Sagarana (publié en 1946). Le monde s'ouvre, le diplomate et l'écrivain font leurs véritables premiers pas, la même année. |
|||
| En mai
1938, nommé consul adjoint, Guimarães Rosa
rejoint son poste à Hambourg, seul, épouse et enfants demeurant à Rio,
poste qu'il
occupera jusqu'en 1942, quand le Brésil rompra ses relations
diplomatiques avec l'Allemagne. Le retour prendra quelques temps, les
diplomates sont consignés à Baden-Baden, quatre mois, en attendant la
conclusion des négociations entre gouvernements sud-américains et
Allemagne nazie. L'Allemagne n'aura pas été que la découverte du vaste
monde (il a en effet voyagé durant son séjour), il a rencontré au
consulat où elle dirigeait le service des visas, celle qui va devenir
sa compagne, Aracy Moebius de Carvalho. La jeune femme est divorcée, elle a un enfant, et malgré les mesures restrictives du gouvernement brésilien, établies en 1937, elle se débrouille pour émettre bien plus de visas que son administration n'en permet, pour ceux qui cherchent à fuir le pays. Le nouveau consul-adjoint semble s'être fait son complice dans cette activité. De fait, des années plus tard, il dira tout le mal qu'il pense des "fascismes" : le "diable" confie-t-il au poète Haroldo de Campos. Le terme a de fortes résonances, autant dire le Mal absolu, chez un croyant tel que lui. Après un mois de séjour à Lisbonne, de retour au Brésil, en juin 1942, il est nommé secrétaire d'ambassade à Bogota (Colombie), où il reste deux ans. Retour à Rio en juin 1944. En 1943, un jugement de séparation a été établi qui dénoue son premier mariage. 1946 : publication de Saganara. Il devient chef de cabinet du ministre des relations extérieures, João Neves de Fontoura, fraîchement nommé, qu'il accompagne à Paris, pour la Conférence de la paix. La même année, Aracy et Guimaraes Rosa se marient au consulat du Mexique de Rio de Janeiro puisqu'il n'existe pas de divorce au Brésil (lui est séparé et elle divorcée de son premier mari, Allemand) . La carrière du diplomate se poursuit sans à-coups, plus régulière que celle de l'écrivain. Il occupe divers postes, dont celui de premier secrétaire d'ambassade à Paris (10 décembre 1948 à mars 1951) où il s'installe avec Aracy. Sa fille aînée, Vilma, viendra les y rejoindre. En 1951, il est de nouveau chef de cabinet du ministre. En mai 1952, il fait un voyage à cheval dans le Minas Gerais en accompagnant un troupeau (neuf bouviers, incluant Rosa, convoyant 360 bovins, Cult, 17 février 2001) Un trajet de 10 jours entre Três Marias et Araçaí, couvrant un peu plus de 200 km. De cette expérience, Rosa tire un certain nombre de textes, dont peu seront publiés mais qui vont alimenter à la fois son recueil de nouvelles, Corpo de Baile, et son unique roman, Grande Sertão : veredas, tous deux publiés en 1956. La carrière de fonctionnaire suit son cours (en 1953, il devient chef de division du département du budget du ministère des affaires étrangères, Itamaraty, puis en 1962, chef de division au service des frontières), et l'écrivain se fait plus présent dans le champ littéraire, publiant divers textes dans revues et journaux, la plupart rassemblés, plus tard, dans les deux livres posthumes qu'organisera son ami Paulo Rónai, Estas Estórias (Ces histoires) et Ave, Palavra (Volatile, vocable). En 1962, l'écrivain publie enfin un nouveau livre, Primeiras Estórias (recueil de 21 contes). L'année suivante, en 1963, il est élu, à l'unanimité, à l'Académie brésilienne des Lettres. Depuis 1957, sa santé s'est détériorée le contraignant à une diète qu'il juge pénible, mais nécessaire. Il lui faut maigrir, cesser de fumer ("Coisa tenebrosa" — chose ténébreuse, dit-il). Il n'en continue pas moins à travailler et à écrire. En 1958, en novembre, il souffre un infarctus. La surveillance médicale s'accentue. Ces soucis sont peut-être à l'origine du long délai qui sépare son élection de sa réception à l'Académie qui n'aura lieu que le 16 novembre 1967, trois jours avant sa mort. En juillet, il avait publié Tutaméia (Terceiras Estórias) qui rassemblait 40 contes ayant paru entre 1965 et 1967 dans la revue médicale, Pulso. C'est son dernier livre. Etonnant à plus d'un titre. Il contient un sommaire et une table des matières, dans laquelle titre et sous-titre sont inversés, ce qui est inhabituel, et quatre préfaces, dont une est bien à la place où le lecteur l'attend, à l'orée du recueil, mais les trois autres à l'intérieur du livre, entre le 14e et le 15e conte, puis entre le 22e et le 23e, enfin entre le 33e et le 34e. Enfin, il porte en sous-titre, "Troisièmes histoires", alors qu'il n'y en pas eu de "deuxièmes" ; au philosophe Benedito Nunes qui lui posait la question, Guimarães Rosa aurait répondu "Ah! ça, c'est un mystère que je ne peux révéler !" En 1926, en rendant hommage à un collègue mort de la fièvre jaune, il disait "as pessoas não morrem, ficam encantadas", une formule qu'il emploiera de nouveau, en 1967, dans son discours académique pour saluer João Neves de Fontoura. Et que l'on a envie de lui appliquer "Les gens ne meurent pas, ils sont cachés" (ou occultés, /ou ensorcelés, au choix). João Guimarães Rosa s'est "occulté" le 19 novembre 1967, et la preuve qu'il est loin d'être mort, c'est qu'il n'a jamais cessé de parler. Il suffit pour l'entendre d'ouvrir l'un de ses livres, et pas seulement au Brésil. Guimarães Rosa laisse une oeuvre se caractérisant essentiellement par sa densité. Nouvelles, contes ou roman, ce n'est pas un écrivain facile (y compris pour un lusophone), en raison, en particulier, de son goût prononcé pour la précision qui va de pair avec celui de la suggestion, la syntaxe qu'il disloque à l'occasion, les trouvailles lexicales (archaïsmes, régionalismes, transcriptions de l'oral — un peu comme le fait Queneau, à l'occasion), inventées au besoin, déconcertent souvent, quoique, très vite, le lecteur en perçoive la justesse, sans toujours parvenir à comprendre pourquoi ; en compensation, il est difficile de ne pas être happé par la force du texte, par delà la compréhension immédiate, par la puissance et la profondeur des interrogations dans lesquelles il entraîne le lecteur ; comme le disait Clarice Lispector à son ami Fernando Sabino (11 décembre 1956) : "Sa langue, si parfaite aussi dans l'intonation, est directement comprise par notre langue intime — et en ce sens, il a fait plus qu'inventer, il a découvert, ou mieux, il a inventé la vérité." Source : "Veredas de Viator", Ana Luìza Martins Costa, in Cadernos de literatura brasileira, Instituo Moreira Salles, 2006. |
||||
|
|
 Guimarães Rosa, mai 1952, photo de Eugênio Silva pour le reportage publié en juin 1952 dans O Cruzeiro. |
||||
| De cette exploitation restent
les villes coloniales, avec leur troupeau d'églises, la peinture, la
sculpture dont le maître reste
l'Aleijadinho. C'est le Minas Gerais que les modernistes (le peintre Tarsila do Amaral, l'écrivain Oswald de Andrade, le poète et essayiste Mario de Andrade),
accompagnés de Blaise Cendrars, parcourent en 1924, en quête d'un Brésil
plus réel, plus authentique, plus brésilien, en somme, que celui des grandes capitales, comme Rio ou São-Paulo. Le Sud, montagneux, fertile, est encore une terre de café. Le centre, le nord et l'ouest, des terres plus sauvages (sertão) vouées à l'élevage. Terres, longtemps, aux mains de grands propriétaires terriens faisant valoir leurs droits (et leurs non-droits) à grand renfort d'hommes de main. La chronique des dernières années du XIXe et des premières années du XXe siècles n'est pas chiche de ces affrontements, et de ces exactions. C'est surtout ce Minas-là que privilégie l'écrivain comme permettent de le saisir les randonnées touristiques (pourquoi pas, après tout !) inventées à partir de ses oeuvres. Mais le Minas Gerais est aussi, en soi, pas seulement à cause de son histoire (laquelle contient aussi son lot de révoltes, dont celle avortée mais toujours célébrée de Tiradentes — le 21 avril, jour de son exécution), un imaginaire auquel fait droit l'écrivain en développant sa description en listes d'adjectifs qualifiant autant la terre "Altière, Etat montagnard, Etat méditerranéen, Centre, Clef de voûte, Suisse brésilienne, " etc, que les hommes qui, dans l'ordre alphabétique, sont caractérisés par 64 vocables, qui vont de "Acanhado - timide, à virtuoso - vertueux" en passant par tous les degrés de l'admiration et de la moquerie, par ex. otário, crétin ou bécasson, selon le degré de méchanceté que l'on veut y mettre, ou encore pão-duro, pingre, pleure-misère. Si bien que les habitants de cet état sont ainsi à la fois vus de l'intérieur, par eux-mêmes, et vus de l'extérieur, par les habitants des autres états, en particulier des grandes villes, comme Rio de Janeiro ou São Paulo. Et l'article se conclut sur cette profession de foi : "Minas en moi, Minas avec moi. Minas" |
 Pluvier d'Azara (Charadrius collaris), "manuelzinho-da-crôa", considéré, dans Diadorim, par le personnage éponyme, comme le plus joli des petits oiseaux (18 cm) des bords du São Francisco. |
|
Une oeuvre
1929/30 |
quatre contes publiés dans la presse (Rio de janeiro), réunis, en 2011, dans Antes das primeiras estórias (non traduit en français). O mistério de Highmore Hall (7 décembre 1929) : [Le mystère de Highmore Hall] une atmosphère de conte gothique qui fait hésiter entre Edgar Poe et Emily Brontë. L'Ecosse, le château en ruines, le vieux fou et le jeune médecin témoin d'événements effrayants. Makiné (O Jornal, 9 février 1930) : le titre est le nom donné à une grotte proche de Cordisburgo. Amusante pochade (on dirait d'une histoire qu'inventerait un enfant, en mêlant à un cadre familier des savoirs acquis à l'école, sur le passé du monde) qui confronte les Tupinambas aux peuples de l'antiquité méditerranéenne venant piller les mines brésiliennes. Chronos kai anagke (le titre était écrit en grec, 31 juin 1930) : [temps contre destin], une partie d'échecs. Conte métaphysique où l'on voit s'ébaucher la dimension mythique qui irrigue aussi l'oeuvre. Caçadores de camurças (12 juillet 1930) : [chasseurs de chamois] autre aspect de l'oeuvre à venir, une attention précise, presque sourcilleuse, au paysage et à toutes ses composantes, géologiques comprises comme au "paysage" humain, aux sentiments troubles. Mais, d'une certaine manière, c'est aussi et dans tous ces contes, la confrontation du Bien et du Mal, du Désir et de la Haine. Guimarães Rosa fait ses gammes. |
 buriti (mauritia vinifera), palmier répandu dans tout le Brésil, solitaire ou en bosquets, il est fort demandeur d'eau. L'écrivain le disait "une affaire de beauté et un palmier différent, métaphysique. Il suffit d'en regarder un pour croire que l'art et le ciel sont des sujets fort sérieux, pays de première nécessité." |
||||
1936 |
Magma,
recueil de
poèmes ("exercices lyriques" dira plus tard l'auteur qui se cachait
alors sous le pseudonyme de Viator), quoique vainqueur du Prix
littéraire de l'Académie brésilienne des Lettres, ne sera publié qu'en
1997, trente ans après la mort de l'auteur. Il est vrai qu'il
considérait que si ce n'était pas si mal que ça, ce n'était pas non
plus "convaincant". (non traduit en français) |
|||||
1946 |
Sagarana (9
nouvelles). Paulo Rónai explique le titre en le décomposant "Saga"
du terme désignant les épopées scandinaves, et "nara" emprunté au tupi
et signifiant "semblable à". Chacun de ces récits étant donc à lire
comme une manière d'épopée exotique. Le livre est issu, après maints
remaniements des 12 nouvelles proposées à un concours en 1938 sous le
titre de "Contes" et le pseudonyme de Viator. Trois en ont été retirées. Traduit en français, sous le même titre, par Jacques Thiériot, en 1997, pour Albin Michel, dans la collection Grandes traductions. |
|||||
1956 |
(janvier ) Corpo de baile, publié en deux
volumes et contenant 7 nouvelles. Mais dès la 3e édition,
l'ensemble est
distribué en trois livres, Manuelzão
e Miguilim, (contient deux nouvelles), No Urubuquaquá,
no Pinhém (trois nouvelles) et Noites
do Sertão
(deux nouvelles).
Cette répartition en trois volumes a été voulue par l'auteur qui
l'avait
proposée à ses traducteurs, avant de la faire agréer
par son éditeur. Pour le cinquantenaire de la première édition, en
2006, le recueil est publié de nouveau, au Brésil, en deux volumes conformes à
l'original. C'est le premier livre traduit en français de l'auteur, en deux volumes, au Seuil, en 1961 et 1962, par Jean-Jacques Villard sous les titres de Buriti et Les Nuits du Sertão. En 1969, le même Jean-Jacques Villard traduira sous le titre Hautes Plaines, les dernières nouvelles. (mai) Grande sertao : veredas. L'unique roman de l'auteur. traduit en français, une première fois en 1965 (Albin Michel. Grandes traductions) par Jean-Jacques Villard, il est retraduit, pour le même éditeur, en 1991, par Maryvonne Lapouge-Pettorelli, sous le titre de Diadorim. |
|||||
1962 |
Primeiras estórias (constitué
de vingt contes préalablement parus dans divers journaux). Traduit en français par Ines Oseki Depré pour les éditions Métailié, en 1982, sous le titre de Premières histoires. |
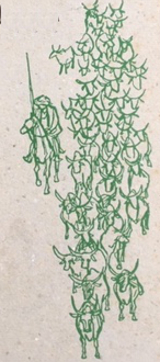 Dessin de Poty. Première de couverture de l'édition 2006, Nova Fronteira, de Sagarana. "J'ai toujours aimé les bovins et les chats, indistinctement. Mais les chats sont plus faciles à élever dans une maison." |
||||
1967 |
Tutameia (terceiras estórias).
Nous avons expliqué, plus haut, les particularités de ce livre au titre
surprenant lui aussi. Il est construit par l'agglutination de
l'expression "tuta-e-meia" (et l'auteur s'en explique, pour les
lecteurs de la revue Pulso,
en rapportant sa graphie à la prononciation entendue durant son
enfance), répertoriée dans les dictionnaires comme
signifiant de "peu de valeur", "bagatelle", "babiole". Et dans une
conversation rapportée par Paulo Rónai, l'écrivain confiait qu'il
l'entendait aussi "tout à moi", en latin dans le texte "mea omnia". En somme, un presque
rien qui dit tout. Quant à "Troisièmes histoires", nous avons rapporté ce que l'auteur confiait à Benedito Nunes ; Paulo Rónai, quant à lui, rapporte ce dialogue avec l'écrivain dans sa postface, 1985 : "Pourquoi Troisièmes histoires [...] s'il n'y en a pas eu de secondes ? — Les uns disent : parce qu'écrites après un groupe d'autres non incluses dans Premières histoires. D'autres disent : parce que l'auteur, superstitieux, a voulu se créer la possibilité et l'obligation de publier encore un volume de contes, qui seraient alors les Secondes histoires. — Et que dit l'auteur ? — L'auteur ne dit rien." (Nova fronteria, 1985, p. 216) Traduit en français par Jacques Thiériot, en 1994, pour Le Seuil sous le titre de Toutameia. Troisièmes histoires |
|||||
1969 (posthume) |
Estas
estórias. Le livre réunit neuf récits d'époques très différentes
; certains provenant (retravaillés) du premier Sagarana de 1938, éliminés de
l'édition de 1946. Traduit en français par Mathieu Dosse, pour les éditions Chandeigne, en 2016, sous le titre, Mon oncle le jaguar et autres histoires. |
|||||
| 1970 (posthume) |
Ave,
Palavra.
Mélange de divers écrits, notes, poèmes, extraits de journal intime,
entre jeux et témoignages. Un certain nombre de textes sont relatifs
aux animaux. |
Curiosité : visiter Cordisburgo et la maison de la famille de l'écrivain, transformée en musée, mais qui a conservé la structure de l'épicerie (caisse enregistreuse comprise) où officiait le père. Découvrir l'auteur et les oeuvres dans l'article de Paulo Rónai (critique, ami de l'auteur, professeur) publié dans Caravelle, cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, n° 4, 1965. |