Le
Totem du loup, Jiang Rong, 2004 / 2007
|
||
| Le roman de Jiang
Rong, Le Totem du loup (Lang Tuteng)
a été publié en chinois en 2004. Il est traduit en français par Yan
Hansheng et Lisa Carducci, et publié par les éditions Bourrin en 2007 ;
en 2009, il sort en livre de poche. En 2010, il en était à sa troisième
réimpression dans cette collection. Après la sortie du film de
Jean-Jacques Annaud, en 2015, le roman est parfois proposé sous le
titre Le Dernier loup. Le livre s'est vendu en Chine comme des petits pains ("2,6 millions d'exemplaires [...], auxquels s'ajoutent 15 millions de copies pirates parfaites" écrit Pascale Nivelle dans Libération, le 7 février 2008) et comme le précisent d'autres critiques, il faut penser aussi aux diffusions via la Toile, et à la circulation des livres, ce qui porte très haut le nombre de ses lecteurs. Il a suscité des controverses et des polémiques qui n'ont fait qu'attiser le feu du succès. Sans compter que son apologie de l'esprit du loup a enthousiasmé tous les chefs d'entreprise aux dents longues qui se sont dépensés pour en répandre les vertus et tous les commentateurs de citer le PDG de la société Hai’er (électroménager et téléviseurs), Zhang Ruimin, affiché en quatrième de couverture : « Après avoir lu Le Totem du loup, j’ai compris qu’il valait la peine d’emprunter beaucoup de manières de combattre utilisées par les loups : ne pas livrer combat sans préparation, savoir choisir le meilleur moment pour frapper, attaquer par surprise… » Nos raisons de le lire ne sont certainement pas celles des lecteurs chinois, et la discussion autour de l'opposition "moutons" / "loups" ne nous importe guère, sauf à titre de curiosité, de même que certains discours "nationalistes" qui dépeignent le monde comme une steppe (le "marché") où les loups (les "occidentaux") dévorent les moutons (la Chine), incitant les Chinois à se faire "loups", pourraient au mieux passer pour le discours d'un personnage encore infantile cherchant à comprendre avec une certaine naïveté, et les moyens du bord, l'Histoire et ses aléas. Heureusement,il y a bien d'autres raisons de s'intéresser à cette oeuvre. |
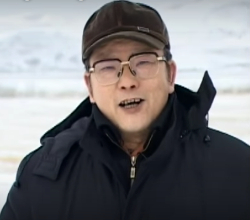 Jiang Rong |
L'auteurJiang Rong est le nom de plume de Lu Jiamin, Pékinois, professeur d'économie et d'histoire / professeur d'économie politique, (dit Frédéric Koller dans Le Temps, 5 mars 2005), à la retraite. C'est son premier roman et à l'en croire, le dernier : "J'ai mis six ans à l'écrire, je le porte dans ma tête depuis trente ans : je n'écrirai rien d'autre » cité par François Busnel dans Lire, février 2008.Il aurait été garde rouge durant la Révolution culturelle avant de choisir d'aller en Mongolie intérieure, en 1967, dans le cadre de "la campagne pour la rééducation par les paysans pauvres". Il explique ce choix par la possibilité qu'offrait ce lieu éloigné d'emporter ses livres avec lui. Rappelons qu'il s'agit d'une période où la littérature était stigmatisée comme "vieillerie". Il y restera 11 ans. Une expérience dont le roman rapporte toute l'importance dans une vie. Et dont il confie à Justin Hill : "It was a year before Mao sent the youth to learn from the countryside. I was inspired by US and Russian literature and especially And Quiet Flows the Don, by Mikhail Sholokhov. I thought I would be more free in a place without settlements. When we arrived in Inner Mongolia many Chinese students felt sad at the conditions we were in. But I was exhilarated because I loved the grasslands and the snow. Each of us got a horse and we went hunting. I experienced a tough and wild freedom. Everyone should be able to experience that freedom." [C'était un an avant que Mao envoie la jeunesse apprendre de la campagne. J'étais inspiré par les littératures américaine et russe et particulièrement par Le Don paisible de Mikhail Sholokhov. J'ai pensé que je serai plus libre dans un endroit sans villages. Quand nous sommes arrivés en Mongolie intérieure, de nombreux étudiants se sont sentis tristes devant nos conditions de vie. Mais j'exultais parce que j'aimais la steppe et la neige. Chacun de nous a reçu un cheval et nous sommes allés chasser. J'ai fait l'expérience de la dure et sauvage liberté. Chacun devrait pouvoir faire l'expérience de cette liberté. ] De retour à Pékin, en 1978, il reprend ses études et devient professeur. Il participe aux événements de Tian An Men (1989) ce qui lui vaut dix huit mois de prison pour "activités contre révolutionnaires" (cf. The Independent, 21 mars 2008). |
|||
|
Le nom de plume (pour un écrivain chinois c'est une longue tradition
pour laquelle cette expression convient mieux que pseudonyme) qu'il
choisit est, comme le roman, un hommage aux peuples
nomades du nord. Jiang reçoit son explication dans une citation de
l'historien Fan Wenlan, placée en exergue du chapitre 33 (le dernier du
livre) : nom de famille de l'empereur Yan : "C'est un nom ethnique des
Xirong, un peuple nomade de l'ouest, le premier à entrer en Chine
centrale". Ce Yan (Yandi) est l'un des empereurs mythiques de
l'histoire chinoise. Quant à "Rong", cela semble avoir été, comme dit
Marcel Granet (La Civilisation
chinoise,
Albin Michel, 1968, p. 92) un
"nom générique sans valeur précise" nommant des "barbares" de l'ouest
et
du nord de la Chine, lesquels aux temps des dynasties mythiques
n'étaient probablement pas des cavaliers comme ceux qui vont, plus
tard, conquérir l'Empire. Il s'agit, en tous cas, d'un nom qui inscrit l'auteur dans un imaginaire particulier, celui même du totem du loup propre à toutes les populations de l'ouest et du nord de la Grande muraille, longtemps "barbares" aux yeux des Han de la Chine centrale. |
||||
 Paysage hivernal, Mongolie intérieure, Chine |
Le romanIl est construit en 33 chapitres plus un épilogue ramenant, vingt ans après leur départ (1997), les deux personnages principaux sur les lieux de leur jeunesse.Chacun des chapitres, hormis le premier et l'épilogue, est précédé de citations tirées de précis d'histoire, soient anciens (les plus nombreux), soient contemporains. Toutes ces épigraphes renvoient aux mythologies, ou aux activités des peuples nomades (la chasse, la guerre). Le roman lui-même est précédé de deux épigraphes relatives aux "Quanrong", un peuple du temps des Zhou (1046–221 av. J.-C.), considéré comme "barbare", d'autant qu'il avait comme totem, le chien, un animal peu apprécié des Chinois. Le titre du roman, le nom de son auteur, et les deux épigraphes initiales proposent de le lire comme un roman d'initiation. Comme le roi Mu des Zhou, les personnages vont ramener de leur expédition en terres étrangères et sauvages, non pas des loups et des daims vivants, mais un esprit, celui du loup, de la nature, de la "grande vie" comme le dit, au cours du récit, leur initiateur. Le roman se déroule sur une année, de l'hiver à l'hiver. Il relate les expériences de plusieurs personnages : Chen Zhen, Yang Ke, Gao Jianzhong et Zhang Jiyuan. Ce sont tous quatre de très jeunes hommes, 20 ans ou à peine plus, étudiants pékinois venus se "rééduquer" auprès des paysans pauvres. Et pauvres, ceux-là le sont, car la vie dans la steppe est extrêmement difficile. S'ils sont quatre, particulièrement suivis par le récit, c'est que leurs expériences se complètent pour donner la vision la plus large d'un mode de vie totalement étranger aux jeunes urbains qu'ils sont en arrivant dans la steppe. Chen Zhen et Yang Ke ont la charge d'un troupeau de moutons, Gao Jianzhong est bouvier, et Zhang Jiyuan s'occupe d'un troupeau de chevaux, la tâche la plus prestigieuse chez les Mongols. Lorsque commence le roman, ils sont installés depuis deux ans et ont acquis leur autonomie, ce qui signifie qu'ils ont appris à chevaucher, habitent leur propre yourte, ont leurs chiens, et se débrouillent seuls. Cette nouvelle période de leur vie, qui commence avec le roman, peut être considérée comme la véritable initiation, celle des "épreuves", la première, les deux ans suivant leur arrivée en 1967, ayant été celle de l'enseignement transmis par le vieux Bilig et pour une autre part, par Gasma, la belle-fille de Bilig, et le directeur de la ferme (le territoire sur lequel ils vivent, la steppe Olon Bulag, est une ferme d'Etat), Ulzii, un homme de la génération de Bilig. La steppe où ils vivent est localisée dès le premier chapitre comme "Située au sud-ouest des monts Daxinganling [...] Elle forme un couloir qui relie le grand désert mongol à la Mandchourie." |
 |
 Marmotte : "Elles sont nombreuses et bien dodues. Elles fournissent une belle fourrure et de la graisse en abondance. C'est l'un des trésors de notre brigade de production." dit le vieux Bilig à Chen Zhen en l'emmenant chasser (chap. 32) |
Les
épreuves consistent à affronter et surmonter les difficultés de la
nature : le froid en hiver, la chaleur intense en été ; les attaques
des loups, en hiver et au printemps, celles des moustiques
(terrifiants) à la fin de l'été ; la faim aussi (voir par ex. le
chapitre 26). En même temps que les hommes doivent survivre, ils
doivent garantir la survie de leurs bêtes, troupeaux et chiens
indispensables aux bergers. Au bout du parcours, ils auront appris à être des êtres humains, solitaires et solidaires, à l'instar du totem, dans lequel ils se sont reconnus, le loup. Le Loup Contrairement à l'imaginaire occidental (français en particulier) qiu voit dans le loup un animal effrayant, il est pour les populations de la steppe, un animal admiré, voire vénéré, ce qui n'empêche nullement de le combattre quand il empiète sur le domaine des hommes. Pour les Mongols, comme Bilig, les loups sont des intermédiaires entre le Ciel (divinité suprème) et les hommes. Ce sont eux qui, après la mort, dévoreront les cadavres qu'on leur abandonne, permettant aux âmes/esprits de rejoindre l'éternité. Ils sont aussi considérés comme des maîtres, "Nous sommes les apprentis des loups" dit le vieux Bilig. C'est en les observant qu'ils améliorent leurs techniques de chasse (apprendre la patience) et qu'ils ont appris à faire la guerre et, pour Chen Zhen, cela renvoie toujours à la puissance de Gengis Khan. Les loups sont crédités par les Mongols d'un gand nombre de qualités, le courage, la puissance, la patience, surtout un sens de la solidarité (chap. 16) dont le vieux BIlig fait l'éloge. Cette initiation à une vie en accord avec la nature, l'acceptation de ses lois, lesquelles sont impitoyables, font aussi de ce roman un récit écologique. L'enseignement du vieux Bilig, sa manière de vivre, en accord avec les croyances des Mongols, consiste essentiellement en explications sur l'écosystème de la steppe et la manière la moins prédatrice possible de l'utiliser, en rappelant que c'est un monde fragile, la couche d'herbe est superficielle, sous elle le sable guette; là où meurt la prairie, le désert s'installe et avec lui les vents de sable qui balaient le nord de la Chine ; là où meurt la prairie, les hommes finissent par mourir à moins qu'ils ne fuient. Dans cet ensemble, les loups jouent un rôle majeur en contrôlant les prédateurs naturels de la prairie, les rats, les marmottes et les gazelles. Quant à l'homme, il contrôle les loups. Par ailleurs, l'homme chasse le même gibier que le loup. Toutefois, si l'homme mange et utilise gazelles, rats, marmottes, il ne mange pas le loup et n'utilise pas sa fourrure, ce qui ne l'empêche pas de la vendre. Les hommes ne sont jamais à une contradiction près. Les hommes aussi ont leur rôle à jouer dans la préservation de la steppe, d'où le nomadisme et le déplacement des troupeaux selon les saisons dans des pâturages divers qu'il s'agit d'utiliser en fonction de leurs particularités : les herbages de printemps ne sont pas ceux de l'hiver ou du plein été. |
|||
| C'est encore Bilig, et Ulzii
occasionnellement, qui va fournir au jeune Chen Zhen, tout ce qu'il
sait sur les loups, leurs modes d'action, en particulier lorsqu'ils
chassent le gros gibier, ce qu'ils font en meute, voire à plusieurs
meutes, lorsque par exemple ils attaquent les gazelles ou les chevaux
une nuit de tempête. La fascination de Chen Zhen remonte cependant à sa
jeunesse, à ses lectures, et peut-être a-t-elle joué aussi son rôle
lorsqu'il a choisi d'aller en Mongolie intérieure. On retrouve chez
lui, cette perception du loup, qui semble bien universelle, faisant de
cet animal, en particulier, une sorte d'incarnation de la Nature, et le
rêve du jeune-homme est d'élever un loup pour le relâcher ensuite et
avoir un ami "sauvage", rêve qui exprime bien à la fois la jeunesse et
la naïveté. Sur le plan symbolique, le destin du louveteau qu'il s'est
approprié, signe, d'une certaine façon son entrée dans le monde adulte. Un roman documentaire En effet, fondé sur l'expérience de son auteur, ce roman déborde d'informations. D'une part, sur le mode de vie traditionnel des Mongols, les difficultés de la vie quotidienne, mais aussi ses moments de joie ; d'autre part, sur les antagonismes existant entre les nouveaux arrivants (dirigeants ou non) ignorant les réalités de la steppe, tenants d'une modernité faite de machines et de rentabilité ; sur les rapports de pouvoir entre dirigeants et paysans ; sur les rapports entre militaires et pasteurs, c'est une zone frontalière et les militaires sont, par ailleurs, une main-d'oeuvre toute trouvée, disciplinée, pour appliquer les directives venues d'en haut qui tiennent rarement compte de la réalité, par exemple augmenter la production de bétail sans se demander si la terre peut supporter cette augmentation sans dommage, ou défricher pour transformer les prairies en terres cultivables sans réfléchir à l'avenir d'une terre épuisée qui fera place au désert. Sans oublier que le récit, se situant à la fin des années 1960 (1969-70 avec des retours en arrière sur les deux années qui ont suivi l'arrivée, en 1967, de Chen Zhen et ses amis), se déroule dans le contexte de la Révolution culturelle, et certains détails, anecdotiques certes, du roman n'en dessinent pas moins une image critique de ces années-là, ne serait-ce que dans la manie de vouloir rendre les hommes responsables de tous les échecs, y compris des aléas climatiques, avec enquêtes, mises en accusation, destitutions. Ainsi de Ulzii rétrogradé de son poste de directeur, redevenant simple berger, et à qui la mesquinerie de ses "juges" n'octroie qu'une vieille rosse pour se déplacer, ce qui choque même le militaire qui l'a remplacé. Sans parler des excès de tous ordres, dont le plus emblématique est bien l'application maniaque de la lutte des classes au monde animal, anecdote du gardien de zoo critiqué pour avoir "préconisé «la réconciliation des classes»" en faisant allaiter un tigre orphelin par une chienne (chap. 11). Conclusion : Le roman est parfois irritant lorsque ses personnages (Chen Zhen, en particulier) se lancent dans des considérations politico-philosophiques qu'on ne peut qu'imputer à leur jeunesse, mais il offre aussi de remarquables pages de combats terribles, des loups attaquant les gazelles, des loups attaquant les chevaux une nuit de tempête, mais aussi de fort belles decriptions de la steppe, un très beau chapitre sur les échanges sonores entre les loups (chapitre 23). Mais son plus grand intérêt est d'inciter le lecteur à réfléchir aux contradictions dans lequelles nous vivons, tous, Chinois ou non. Nous avons compris qu'il nous faut préserver la nature, pour nous préserver nous-mêmes, mais nous ne savons pas comment faire. Les écosystèmes sont fragiles, nous le savons. Détruire les forêts, ou les océans comme nous le faisons, ou détruire la steppe, c'est à long terme mettre en danger l'espèce humaine. Mais d'un autre côté, les humains ont besoin de se nourrir, il n'y a pas de raison pour qu'ils vivent dans des conditions extrêmes. Les personnages du roman sont bel et bien pris dans ces contradictions. Les vieux, Bilig ou Ulzii, possèdent des connnaissances sur la steppe, sa flore, sa faune et leur interdépendance tout en étant soumis à une tradition, et peut-être à des réflexes de vieilles personnes qui ne veulent rien voir changer du monde qui a été le leur. Les jeunes Mongols, eux, se font les alliés des dirigeants chinois, par goût pour la nouveauté, certes, mais aussi par rationalité : la moto est plus pratique que le cheval, disposer d'un hôpital et de médecins, d'écoles, ne peut pas s'interpréter comme un mal. Celui qui peut être dit le personnage principal, Chen Zhen, est, lui-même, assailli de contradictions, de désirs opposés. Comment concilier amélioration de la vie quotidienne et préservation de "la grande vie", comme dit Bilig, c'est-à-dire de la Nature qui nous est aussi vitale ? C'est sans aucun doute la grande question du XXIe siècle. Le mérite du roman de Jiang Rong est de la poser, sans fournir de réponse, au demeurant, car si réponse il y a, elle est encore à inventer. La leçon vraie du loup est peut-être celle-là, observer, attendre, avoir la patience nécessaire pour laisser s'inventer des réponses efficaces, ni retour en arrière, ni course délirante vers toujours plus de techniques, apprendre à faire la part des choses. |
||||
A lire : un article de Noël Dutrait lors de la sortie du roman en français. |