Forêt
vierge, José Maria Ferreira de Castro, 1930/1938
|
||
| Le roman de José
Maria Ferreira de Castro a été publié en 1930, au Portugal, sous le
titre A Selva. Il a connu un
très grand succès qui s'est manifesté par
des traductions dans de nombreux pays, d'abord en allemand, puis en
anglais. Sans doute est-ce ce qui a attiré l'attention des éditions
Grasset (la présentation dans les Cahiers rouges attribue à Stefan
Zweig le rôle de passeur) qui en demandent la traduction à Blaise
Cendrars. C'est chose
faite en 1938. C'est toujours cette traduction que l'on peut rencontrer
à la fois en livre de poche et dans la collection Cahiers rouges de
Grasset. |
 Photographie de Ferreira de Castro (date et auteur inconnus) |
L'écrivainIl est né le 24 mai 1898 à Ossela, Oliveira de Azemeis (Portugal) dans une famille de paysans pauvres. Le père meurt alors qu'il n'a que 8 ans.En 1911 (il a 13 ans), école primaire à peine terminée, il émigre au Brésil dans l'espoir d'y trouver de quoi faire vivre sa famille ; il est l'aîné de 4 enfants ; il a deux frères et une soeur. Sur ce voyage, ses conditions, son arrivée à Belém, les informations manquent, mais il est patent que la même année 1911, ce sont 10.000 jeunes Portugais de moins de 14 ans qui émigrent, seuls, vers le Brésil (Bernard Emery, 1992). Il va travailler à l'exploitation du latex, dans la forêt, sur le Rio Madeira, jusqu'à 16 ans. Son expérience de collecteur de latex ne dure pas, en fait, et il est assez vite employé aux écritures de l'exploitation. Il va lire tout ce qui est alors disponible dans ce bout du monde et écrire, écrire. Ce très jeune homme n'envisage rien d'autre dans sa vie, sinon l'écriture. En 1914, de retour à Belém, il vit de petits métiers, travaille dans plusieurs journaux, en lance même un, publie son premier roman, Criminoso por ambição — Criminel par ambition (1916) qu'il vend lui-même en faisant du porte à porte. Il finit par se faire connaître, voyage dans le sud, à Rio de Janeiro (la capitale) et São Paulo mais, en 1919, repart pour le Portugal. C'est un nouveau début. Personne ne se soucie de lui, à Lisbonne, et ses succès de Belém sont inconnus. Il faut tout recommencer, publier, écrire pour les journaux, mais Ferreira de Castro est tenace et, surtout, il a du talent. En 1925, il est reconnu dans le milieu journalistique au point de devenir président du syndicat en 1926. En 1927, il rencontre Diana de Liz (pseudonyme de Maria Eugénia Haas da Costa née en 1892), elle-même écrivain. Elle devient sa compagne. Deux romans vont alors rompre avec la veine littéraire jusqu'alors poursuivie par Ferreira de Castro, Emigrantes en 1928 (Emigrants, traduit en 1948 par A. K. Valère) et en 1930, celui qui va lui donner une renommée mondiale, A Selva. Mais c'est aussi une année terrible parce que Diana meurt de la tuberculose dont elle est atteinte. |
|||
| En 1934, il abandonne le
journalisme, jugeant impossible d'exercer
cette profession sous un régime de censure. Depuis un coup d'Etat, en
1926, le
Portugal va de dictature en dictature et Salazar, ministre des finances
depuis
1928, s'impose jusqu'à concentrer tous les pouvoirs entre ses
mains. Même après sa mort, en 1970, le pays souffrira encore, malgré
une certaine ouverture à partir de 1968, d'une forte répression
politique. Il faudra la Révolution des Oeillets qui éclate le 25 avril
1974, pour
que le Portugal retrouve les voies de la démocratie. Ferreira de Castro
aura eu le bonheur avant de mourir cette année-là, en juin, de
participer à un premier mai de défilés fêtant la liberté retrouvée. Toute sa vie, l'écrivain a publié, mais aussi voyagé. Avec Elena Muriel, peintre espagnole en exil, épousée en 1938, il a réalisé son rêve de faire un tour du monde, en 1939. Ferreira de Castro a été un écrivain soucieux du monde et des autres. Si Forêt vierge a été le roman qui l'a fait connaître, pour son dernier roman (O Instincto supremo, 1968, traduit par Georgette Tavares-Bastos sous le titre Mourir peut-être, 1970), il retrouve les chemins de la forêt en s'inspirant des faits et gestes du maréchal Rondon (1865-1958) dans son approche des peuples autochtones d'Amazonie et du Mato-Grosso, dont le titre français reprend la maxime "mourir s'il le faut. Tuer jamais / Morrer, se preciso for. Matar, nunca". |
||||
La traductionQuelques mots de la traduction, dont Ferreira de Castro était enchanté, comme le prouvent les lettres échangées entre les deux écrivains entre 1938 et 1958.Cendrars l'a fait précéder d'une introduction dans laquelle il loue tant l'auteur que le livre, prévient que la traduction en a été difficile, et qu'il a "voulu échapper à l'emprise de la phrase portugaise", autrement dit, il reconnaît implicitement offrir ce qui, en d'autres temps, a été nommé "belle infidèle" : il a supprimé les épigraphes, sauf la dernière d'Euclides de Cunha, la dédicace, l'avant-propos de l'auteur, donne des titres aux quinze chapitres du roman, supprime des passages entiers, en rajoute de son cru, parfois de manière quelque peu dommageable, par exemple en colorant de racisme un certain nombre de remarques relevant plutôt de la lutte des classes, ou en traduisant le "Seu" habituel pour s'adresser poliment à un homme en "missié" qui se trouve ainsi n'appartenir qu'à un seul personnage. Bref, le roman de Ferreira de Castro se voit transformé en roman de Blaise Cendrars. De fait, il est possible de s'interroger : traduction ou adaptation ? dans la mesure où Cendrars s'est, en fait, appuyé sur une traduction existante de Jean Coudures à qui était dédié la première édition (la dédicace a disparu dans la réimpression de 2017) : "C'est à vous, mon cher Jean Coudures, qui avait traduit A Selva bien avant moi, dans un coup d'enthousiasme juvénile, alors que vous étiez étudiant et n'aviez pas la moindre idée de ce qu'est en réalité la forêt vierge [....] que je dédie ma traduction du chef-d'oeuvre de Ferreira de Castro" (Cité par Adalberto de Oliveira Souza, 1995). Manière de souligner que lui détient cette connaissance, or il suffit de lire "En transatlantique dans la forêt vierge" publié en feuilleton dans Le Jour, en 1935, et collationné dans Histoires vraies (décembre 1937) pour constater que l'Amazonie de Cendrars doit beaucoup à Jules Verne (La Jangada) et à sa propre imagination qui la colore de fantastique. De fait, autant qu'on le sache, il n'a jamais mis les pieds dans le bassin amazonien lors de ses trois séjours au Brésil. Pourtant, dans l'ensemble, l'univers et l'atmosphère du roman de Ferreira se transmettent, quoique, parfois, la forêt qu'évoque Cendrars se rapproche davantage de l'imagination du Douanier Rousseau que de la précision descriptive de Ferreira de Castro. |
 Le Douanier Rousseau (1844-1910), "Le lion ayant faim se jette sur l'antilope...", 1905, détail. |
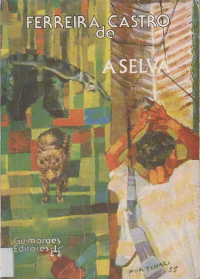 Première de couverture de A Selva, Guimaraes ed., Lisbonne, 1955 (38e édition), peinture de Portinari (1903-1962). |
Le romanPublié en 1930 et rédigé, selon ce qu'en dit l'auteur, entre le 9 avril et le 29 novembre 1929, il s'enracine dans son expérience, mais n'en est pas moins un roman, "car s'il est vrai que dans ce roman l'intrigue s'éloigne souvent de ma vie, il n'en est pas moins vrai aussi que la fiction se tisse sur un fond dramatiquement vécu par son auteur" écrit-il dans la postface de l'édition de 1955, illustrée par Portinari.Il lui aura fallu quinze ans pour finalement trouver ce qu'il voulait dire, au-delà du témoignage, et surtout, comment le dire, à travers quels ressorts romanesques. Le roman est dédié à Diana de Liz et s'ouvre sur trois épigraphes dans l'édition portugaise. La première de Tavares Bastos (1839-1875), journaliste et homme politique, empruntée à son livre, Vale do Amazonas, publié en 1866, soulignant la mélancolie qui s'empare de l'homme dans "les plus denses solitudes du monde". Un sentiment que le personnage principal du roman ressent souvent au cours de son séjour. La deuxième, d'un certain De Pinedo souligne ce que l'expérience peut avoir d'indélébile : "Etre forcé de descendre dans cette horreur, même si on aterrit indemne, c'est rester où on est descendu et mourir enseveli dans l'ombre" et la troisième, une affirmation d'Euclides da Cunha (1866-1909) : "Vraiment, l'Amazonie est la dernière page, encore à écrire de la Genèse" empruntée à la préface de Inferno verde (Enfer vert), recueil de nouvelles d'Alberto Rangel (1871-1945) publié en 1908. Après un très bref avant-propos saluant à la fois la forêt et les hommes qui y travaillent, le livre se définissant comme "un chapitre de l'oeuvre qui doit inscrire le terrible cheminement des déshérités au cours des siècles, en quête de pain et de justice", le roman se déploie sur 15 chapitres non titrés. L'action se passe au début des années 1920. La fable : c'est l'histoire d'Alberto, 26 ans, Portugais exilé à Belém do Pará pour avoir participé à un complot monarchiste qui a échoué (janvier, février 1919). L'oncle qui l'a accueilli se débarasse de lui en le faisant embaucher par le recruteur d'une exploitation de latex sur la rivière Madeira. Le jeune homme y sera d'abord cueilleur de latex (peu efficace) avant d'y devenir comptable et de finir par quitter l'exploitation après s'y être transformé. D'une certaine manière, il s'agit d'un roman d'apprentissage tout autant que d'un roman documentaire. Un roman documentaire |
|||
 4e de couverture de Forêt vierge, traduction de Cendrars, livre de poche, 1966 |
Le journaliste Ferreira de Castro est bien aux commandes de ce roman.
Il le dit dès son avant-propos en précisant que son livre est d'abord
celui de la forêt amazonienne, puis celui des hommes qui y vivent et
y meurent souvent. C'est, en effet, d'abord la forêt et tout le réseau hydrographique avec lequel elle se développe en symbiose qui occupe une très grande partie du roman. Vue le plus souvent par les yeux du personnage principal, elle est tout autant source d'émerveillements que de frayeurs. Elle apparaît le plus souvent comme un être vivant et dévorant, en soi, pas seulement parce qu'elle abrite (et alimente) des bêtes féroces, au premier rang desquels les jaguars, des dangers multiples et la plupart du temps invisibles, insectes de tous ordres, porteurs de diverses maladies en sus, et serpents, parce que d'elle peuvent surgir (et surgissent) les Parintintin qui, de fait, ont mené jusqu'au début des années 1920, des raids continuels contre les exploitations de latex tout le long du Madeira. La fécondité de la forêt terrifie le personnage, tout autant que l'alliance perpétuelle entre la vie et la mort qui la permet. La pourriture est partout, dans les feuilles, les fourrés, les branches mortes, les arbres arrachés par les inondations, les poissons tués par le retrait subit des eaux. Sur le plan-là le roman est aussi un traité de botanique tout autant qu'une incursion zoologique. Il est aussi un documentaire sur la vie des fleuves, les basses eaux de l'étiage et les crues qui font déborder le fleuve dans la forêt, pas tout à fait comme dans le déluge qu'imagine Cendrars, mais de manière assez significative pour que dans, les villes riveraines, les appontements soient fluctuants. Il ne néglige pas pour autant d'informer sur l'histoire de la colonisation, puisque dans le chapitre consacré à la remontée du Rio Madeira le narrateur relate les avancées de l'exploration portugaise à partir des tout débuts du XVIIIe siècle. Le documentaire ne néglige ni la géographie des fleuves, ni le dévelopement des deux villes qui se sont enrichies du caoutchouc, Belém do Pará à l'embouchure et Manaus (Manaos) aux confluents du Rio Negro et du Solimões. Sans oublier les difficiles relations entre les peuples premiers et les colonisateurs qu'explique, par exemple, un des personnages, "Ils comprennent que cette terre est à eux, que nous sommes ici des intrus et ils ne nous le pardonnent pas." Mais c'est aussi et surtout un roman sur les conditions d'exploitation du latex naturel destiné à la fabrication de caoutchouc, depuis les conditions de vie des ouvriers, lamentables, faut-il le préciser, l'exploitation quasi esclavagiste dont ils sont les victimes, le repérage des arbres dans la forêt, reliés entre eux par un sentier ("une piste quasi imperceptible dans les feuilles mortes et les racines") qui fait boucle, partant du campement et y revenant, les méthodes de travail, le troc final qui n'en finit pas d'alourdir la dette initiale du travailleur et cela, d'autant plus, que Ferreira a choisi pour son roman le début des années 1920, période du déclin accentué du latex brésilien face aux latex asiatiques. Il fait aussi une place à l'arrivée des premiers émigrants japonais (chap. 14) qui, en vérité, sont arrivés un peu plus tard, au tournant de 1920/1930 mais qui permet d'envisager l'avenir de la région après le caoutchouc. L'expérience vécue de Ferreira de Castro s'est aussi appuyée sur une documentation littéraire et, en particulier, sur l'oeuvre d'Alberto Rangel dont il rejoint souvent le lyrisme, tout autant que la dénonciation des injustices sociales. |
Excursus : le caoutchouc
Le mot vient sans doute du Quechua et il
est diffusé par La Condamine ("J'envoyais, en 1736, à
l'Académie [...] quelques rouleaux d'une masse noirâtre et résineuse,
connue [...] sous le nom de caoutchouc
(Cauchuc suivant l'orthographe
espagnole). C'est le nom que donnent à cette matière les Indiens de la
province de Maïnas"). Les
peuples autochtones en faisaient des balles rebondissantes pour jouer,
des semelles aptes à protéger les pieds (si bien qu'on pourrait
considérer que les havaïanas contemporaines en sont les héritières
quoiqu'imaginées à partir de sandales japonaises). Mais le produit
était instable. Il était recueilli de divers arbres de la forêt
amazonienne, dont le plus important est l'Hevea brasiliensis (que les
Brésiliens appellent Seringueira,
d'où le nom de seringueiros
donné aux collecteurs de latex) qui fournit la meilleure qualité de
latex. Au XIXe siècle, un certain nombre de
découvertes vont
accélérer l'utilisation industrielle de cette matière première, en
particulier celle de la
vulcanisation par Charles Goodyear. Ce qui a été appelé le "boum"
du caoutchouc va se développer entre 1850 et 1910 avec une forte
impulsion dans les années 1880. La demande s'accélère avec les
innovations techniques, comme la bicyclette ou l'automobile. Les deux
états brésilien du Pará et d'Amazonas vont particulièrement bénéficier
de cette situation. La population augmente de manière très sensible,
Brésiliens venus d'autres régions (en particulier de l'état du Ceará
qui, à la fin du siècle, connaît des périodes de terribles sécheresses)
mais aussi migrants, le plus souvent européens. C'est une période
propice à l'accumulation rapide de richesses pour les hommes comme pour
les villes. L'exemple le plus significatif en étant le théâtre de Manaus
inaugué en 1896. Mais qui dit accumulation de richesse d'un côté, dit
aussi exploitation et misère de l'autre. Le travail dans les
exploitations relevait du travail forcé dans la mesure où le
travailleur arrivait sur place déjà endetté (les frais du voyage,
l'achat du matériel ayant été avancés par le patron) et que cette
dette avait plutôt tendance à s'accroître qu'à décroître (Euclides da
Cunha en fait un compte terrible, en 1906, dans Amazônia um paraíso perdido
—Amazonie, un paradis perdu). |
 Collecteur de latex, photographie illustrant le livre de Paul Walle, Au pays de l'or noir, 1909. |
 Barques et "seringueira" au bord du Rio Negro, similaires à ce qu'elles pouvaient être sur le Rio Madeira. |
Un roman d'apprentissageSi le récit est rapporté par un narrateur omniscient, celui-ci glisse souvent en focalisation interne pour faire partager au lecteur les anxiétés, les peurs, voire les admirations du personnage principal, Alberto. Celui-ci arrive au Brésil imbu de ce qu'il croit sa supériorité, celle du Portugais dans la "colonie", celle de l'étudiant (il a fait quatre ans de droit) face aux "analphabètes", celle du "monarchiste" dont la vision du monde est profondément hiérarchisée, à son profit et celui de ses semblables. Il va d'abord être confronté à son déclassement. Traité, sur tous les plans, matériel et psychologique, comme ceux qu'il juge ses inférieurs, par ceux auxquels il aurait eu tendance à s'identifier d'abord, c'est toute sa vision du monde qui va basculer. Progressivement, il découvre que les hommes et le monde sont bien plus complexes que son expérience, finalement très étroite, lui permettait de penser. Ceux qu'il imaginait ses pairs naturels, les recruteurs-cadres de l'exploitation, Balbino (l'élégant), Caetano, Binda (le magasinier) et le propriétaire lui-même, Juca Tristão, ne voient en lui qu'un travailleur de plus à exploiter ; ses compagnons de misère, si méprisés au cours du voyage vers l'exploitation qui porte le nom antinomique de "Paradis" (Paraiso) vont se révéler, pour certains, ses supérieurs en termes de courage, de maîtrise de la réalité, de générosité : Firminio, le cueilleur de latex, ou Tiago, le vieux noir que la cruauté de son patron à l'égard d'autrui poussera à la révolte, Lourenço, le caboclo accueillant, João le cuisinier. Il est vrai que le comptable, toujours nommé "Monsieur Guerreiro" (la cinquantaine, grisonnant, un homme pondéré et respectueux d'autrui), se montrera amical lorsqu'Alberto travaillera au magasin, un an après son arrivée. |
|||
| C'est un univers masculin
dont sont absentes les femmes. Il n'y a que
deux femmes sur l'exploitation, "Nha Victoria" ("la négresse
Victoria") mère de
l'exécuteur des hautes et basses oeuvres du patron, Alexandrino, une
femme de soixante ans, et Dona Yaya, l'épouse de Monsieur
Guerreiro. Tous ces hommes souvent jeunes, en souffrent, ce qui se
traduit par de nombreux fantasmes (la forêt s'en trouve singulièrement
érotisée), par des actes de violence ou des comportements qui
ahurissent Alberto quand il les découvre. La prise de conscience du personnage est progressive. Il commence par découvrir que les misérables si méprisés ont une histoire, à la fois présente, celle de leur exploitation, de leurs conditions de vie dans laquelle les rigueurs de la forêt, inhospitalière pour eux, s'ajoutent au traitement que leur réserve un patron dont le lucre est le seul objectif, mais aussi passée comme ils le racontent au cours de l'hivernage, les sécheresses à répétition au Ceará, en 1877-79, en 1915, entraînant de désastreuses migrations, désastreuses en raison du nombre de morts en chemin ; lorsqu'il débute comme magasinier, il découvre son statut de domestique (on le fait manger à la cuisine) et revient sur la façon dont lui-même avait, autrefois, traité la bonne de ses parents, et ses convictions monarchiques en prennent un sacré coup (Cendrars ne traduit pas cette avancée dans la transformation du personnage pourtant essentielle dans le projet de Ferreira de Castro). L'étude des livres de comptes dessinera plus précisément encore les conditions d'exploitation des travailleurs. Mais Ferreira s'attache aussi à montrer comment s'articulent, souvent dans la confusion, l'individualisme du personnage et sa lente appréhension de la solidarité qui finit par conduire à la fraternité. Il lui faudra se trouver confronté à la violence, violence à l'encontre des malheureux et violence en retour, pour s'accepter, ni meilleur ni pire qu'autrui, et choisir "de se vouer au droit civil, à une carrière consulaire ou à la défense, seulement la défense si la nécessité l'obligeait à se pencher sur l'abîme insondable des délits humains." L'apprentissage est donc double, à la fois sur le plan intérieur, le personnage apprend à voir ce qu'il en est vraiment de lui, de ses désirs, de ses pensées, de ses impulsions, loin d'être toujours honorables qu'il s'agit de connaître et de contrôler, et sur le plan de ses relations avec autrui, il apprend à écouter, regarder, comprendre ceux dans lesquels, au départ, il se refusait à voir des semblables, de même qu'il comprend que ceux qui ont le pouvoir ne sont pas plus légitimés à le posséder que d'autres, d'autant moins qu'ils en abusent. C'est un très beau roman qui mériterait une nouvelle traduction, plus fidèle à l'original que celle de Cendars, malgré sa beauté propre. |
||||
Pour en savoir plus sur les recherches relatives à l'Amazonie, un article de The Conversation (en français), recension d'un livre de Stéphen Rostain, janvier 2022. et sur le caoutchouc, un article de Jean-Claude Maillars (1992) "«Cahuchu» (le bois qui pleure) la «success-story» d'Hevea brasiliensis" A découvrir : le site du Musée de l'exploitation du Caouchouc (Museu do Seringal, Manaus), qui propose de nombreuses photos des lieux. L'histoire du musée est amusante car c'est d'abord le décor d'un film tourné par Leonel Vieira, en 2002, adapté du roman, qui a reconstitué les espaces composant une exploitation (maison de maître, magasin, chapelle) et les campements des ouvriers (baraquement, fumoir, sentier d'exploitation dans la forêt). Les accessoiristes avaient fait un travail remarquable de reconstitution (tous les objets sont du début du XXe siècle) resté en l'état. |