Les
Quatre saisons, Leonardo Padura, 1991-1998
|
||
La tétralogie des Saisons (Cuatro estaciones en la Habana) n'a été envisagée comme telle qu'après l'écriture du deuxième texte autour du personnage de Mario Conde. Selon ce que rapporte Jon Lee Anderson (The New Yorker, 21 octobre 2013), le premier roman, Passé parfait, terminé en 1990, s'est vu refuser l'édition à Cuba ; Padura, grâce à l'intervention de Paco Ignacio Taibo II, le voit publier par Les presses de l'université de Guadalajara (Mexique) ; à partir des réactions favorables des lecteurs, il affirme avoir découvert que Mario Conde "était un reflet des problèmes et des frustrations de [sa] génération" et qu'il méritait de vivre dans d'autres livres. Dans sa "Note de l'auteur" introduisant L'Automne à Cuba, dernier volet de la tétralogie, Padura donne une version plus romanesque de cette décision puisqu'il en attribue la responsabilité à son héros. Mais peut-être est-ce même l'accueil du deuxième roman, Vents de carême, en 1993 (dont la publication avait été soutenue par le président de l'Union des écrivains et artistes de Cuba, Abel Prieto, qui deviendra ministre de la Culture quelques années après), suivie de la publication à Cuba même du premier, qui l'a poussé à poursuivre la veine de son exploration, celle de l'année 1989 dont le poids a été si dramatique pour l'avenir des Cubains privés de leurs relations privilégiées avec une URSS disparue et toujours soumis à l'embargo étasunien. Il est parfois terrible d'être une île. C'est sans doute ainsi qu'est née l'idée des Saisons puisqu'il y en avait déjà deux, l'hiver du premier roman, le printemps du deuxième. Le troisième, Electre à La Havane, se déroule donc en été. Il a été publié en 1997. Et le dernier, L'Automne à Cuba, publié en 1998, situe son action en automne comme le dénote son titre. Ces quatre récits ont été écrits durant une des périodes les plus dures que la population cubaine ait dû affronter dans une pénurie presque totale. Plus que des romans policiers, ce sont des romans noirs, dans la veine de Chandler (et Conde, parfois, dans son scepticisme et sa mélancolie n'est pas sans rappeler Marlowe) ou d'Hammet, c'est dire qu'ils explorent à la fois les méandres des êtres et de la société qui les produit. Et ce sont de beaux romans, tout court, avec juste ce qu'il faut d'ironie et de lyrisme, de brutalité et de chagrin, pour créer une atmosphère, la fameuse "petite musique" qui est la signature propre d'un écrivain. Si bien que ce sont moins des intrigues (qui, comme dans tous les romans policiers, sont assez convenues) que cette atmosphère baignée de mélancolie et de regrets et, en même temps, d'une énergie et d'un amour de la vie éclaboussants que les lecteurs aiment à retrouver dans ces quatre romans. |
L'auteurIl est né à la Havane le 9 octobre 1955, Leonardo Padura Fuentes, dans un quartier excentré de la capitale, Mantilla (à une demi-heure de route du centre), où il a grandi et où il habite toujours, dans la maison construite par ses parents en 1954, qu'il a agrandie après son mariage avec Lucia Lopez Coll, à laquelle tous ses romans sont dédiés.Il entre à l'université en 1975 pour y étudier la littérature hispano-américaine ; il y fait la connaissance de Lucia, en 1978 ; diplômé en 1980, il entre comme rédacteur au supplément littéraire, El Caimán Barbudo [Le Caïman Barbu], du journal destiné à la jeunesse, Juventud rebelde [Jeunesse rebelle]. Il dit y avoir appris le métier de journaliste, ce qui s'entend comme l'attention portée aux détails de la vie quotidienne comme l'apprentissage vécu des réalités de son pays et de sa société. En 1983, un de ses articles subit les foudres de la censure et il est "rétrogadé", en somme, dans le quotidien lui-même; plus de littérature, en apparence, puisque le quotidien, lui, s'occupe d'information. En 1985-86, il passe une année comme correspondant à Luanda (Angola). Rappelons que les Cubains ont participé à une partie de ces terribles et interminables guerres africaines qui ont suivi de près les indépendances (en Angola, cela va durer jusqu'en 2002 même si les Cubains se retirent en 1991). De retour à La Havane, il ne reste plus longtemps à Juventud rebelde puisqu'il devient, en 1990, éditeur de la Gaceta de Cuba, et le reste pendant 5 ans. Et même s'il a déjà écrit et publié, des essais sur la littérature (Alejo Carpentier, par exemple) mais aussi sur le base-ball ou la musique, quelques nouvelles, c'est vraiment à partir de ces années 1990 qu'il plonge en littérature. Malgré les difficultés économiques, malgré les difficultés politiques (il n'est pas toujours aisé de se débrouiller avec le "réalisme socialiste", fichue doctrine inventée en URSS visant à transformer tous les artistes en propagandistes), Padura n'a jamais envisagé de s'exiler : "Je me suis enterré profondément moi-même dans Cuba de sorte que je peux exprimer ce qu'est Cuba, et je n'ai pas quitté Cuba parce que je suis un écrivain cubain [c'est lui qui souligne] et je ne peux être rien d'autre." En collaboration avec Lucia, il a écrit des scénarios pour le cinéma et la télévision. A l'exception de son premier roman, Fiebre de caballos (1988) et de ses essais, toutes ses oeuvres ont été traduites en français et publiées aux éditions Métailié. En 2012, il a reçu le Prix National de littérature décerné par l'Institut cubain du Livre et remis officiellement lors de la Foire Internationale du livre (pour lui, la 22e qui s'est tenue en février 2013). En 2015, en Espagne, le prix Princesse des Asturies. Sans compter les autres, nombreux, dans divers pays qui ont salué, à juste titre, une oeuvre remarquable. |
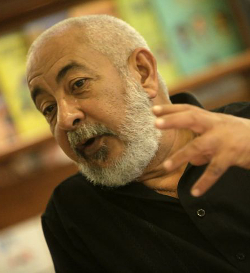 Leonardo Padura, Paris, 2017
|
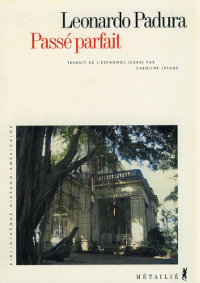 Première de couverture, éd. Métailié, 2001. |
Passé parfaitLe premier roman de la série (Pasado Perfeto) a été traduit en français par Caroline Lepage et publié en 2001.L'intrigue se déroule sur trois jours, début janvier 1989. Son héros, Mario Conde, est policier depuis dix ans, "à se vautrer dans les cloaques de la société", la trentaine bien entamée. Lieutenant au commissariat central de La Havane (inutile de chercher sur les cartes, ce bâtiment n'existe pas plus que Mario Conde), il est chargé par son patron, le Major Rangel dit Le Vieux, de retrouver un jeune cadre dynamique (Rafael Morín Rodríguez, chargé d'import-export au ministère de l'industrie) dont l'épouse a signalé la disparition. Il se trouve que Conde a été le condisciple de Rafael au lycée ; qu'il a été fou amoureux de la femme que ce dernier a épousé. Le roman va donc tisser le rythme de l'enquête au présent, tendue vers le futur de sa résolution et le rythme de la mémoire de Conde qui, cherchant à comprendre ses sentiments à l'égard de celui dont on dirait que tout lui a réussi, découvre ou retrouve ses propres échecs au cours de cette longue anamnèse, dont ses deux mariages ratés et surtout son renoncement à l'écriture. L'enquête est racontée par un narrateur omniscient et la masse des souvenirs à la première personne, ce qui revient à en signaler la subjectivité, la difficulté sinon l'impossibilité de déterminer si les faits relatés correspondent à une réalité ou à l'affect qu'elle a produit. L'entrelacement est d'autant plus efficace que le texte est d'un seul tenant, sans aucune division de chapitres marquée, sauf entre les deux premiers jours et le troisième. Bien sûr, le roman est propice à la découverte d'un univers, d'une société sur laquelle depuis tant d'années s'accumule un brouillard de fantasmes, négatifs le plus souvent, "la dictature", positifs parfois, mais plus rarement. Bien sûr aussi, il s'agit d'un roman policier et les aspects d'une société, quelle qu'elle soit, avec lesquels les policiers doivent se débrouiller ne sont pas les plus reluisants. Or donc, le lecteur découvre qu'à La Havane, comme à Paris ou à New York, il y a des délinquants, des criminels, des qui opèrent dans la rue, et d'autres dans les bureaux du pouvoir ; qu'il y a des privilégiés et des laissés pour compte ; des plus pauvres que d'autres. Mais il y a aussi autre chose, "l'âme" de La Havane, ses odeurs, ses couleurs, son architecture déglinguée par tant d'années de pauvreté, et pourtant la force inouïe de son charme. |
|||
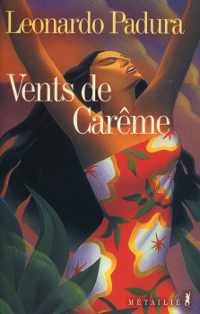 Première de couverture, éd. Métailié, 2004. Illustration Cathleen Toelke, 1993 (illustratrice étasunienne) |
Mario Conde a grandi dans un quartier très populaire dont il a tiré son
éthique, un "machisme" élémentaire, des préjugés de tous ordres, un
sens de l'honneur qui passe par la bagarre (car il s'agit toujours de prouver qu'on a des
"couilles" avec les poings), une indéfectible
fidélité en amitié, une grande violence verbale (malgré ses années
d'université), la passion du base-ball, un goût immodéré pour le rhum,
le tabac, les femmes aux fesses plantureuses et la littérature. Le roman est aussi, surtout peut-être, une méditation sur la mémoire, car ce "passé parfait", celui des souvenirs de l'enfance et de l'adolescence, cet élan de la jeunesse auquel Mario Conde se raccroche, "un passé où tout avait été simple et parfait", se découvre progressivement plus troué qu'un vieux pull mangé de mites et par la même occasion, comme son sens grammatical l'indique, définitivement perdu. Vents de carêmeLe deuxième (Vientos de cuaresmas) a été traduit en français par François Gaudry et publié en 2004.Ne résistons pas au plaisir de citer l'incipit : "Printemps 1989 C'était le mercredi des Cendres et, avec la ponctualité de l'éternel, un vent aride et suffocant, comme envoyé directement du désert pour remémorer le sacrifice nécessaire du Messie, s'engouffra dans le quartier, soulevant les détritus et les angoisses. Le sable des carrières et les vieilles haines se mêlèrent aux rancoeurs, aux peurs et aux déchets débordant des poubelles, les dernières feuilles mortes de l'hiver s'envolèrent avec les émanations fétides de la tannerie et les oiseaux du printemps disparurent, comme s'ils avaient pressenti un tremblement de terre. L'après-midi se flétrit sous des nuées de poussière et respirer devint un exercice conscient et douloureux." L'intrigue policière démarre ici directement sur le meurtre. Une jeune femme a été assassinée chez elle et les apparences laissent à croire qu'elle a été violée et torturée. Elle était professeur de chimie dans le lycée où Mario Conde a fait ses études. Mario Conde mène l'enquête avec son acolyte, le sergent Manuel Palacios, Manolo, qui adore conduire aussi vite que possible, écouter la radio en voiture, raison pour laquelle il ôte toujours soigneusement l'antenne de son véhicule, "par mesure prophylactique" dit Mario Conde, et tomber amoureux ; de ramifications en ramifications, se dévoilent toutes sortes de trafics, de la vente de sujets d'examen à ceux plus lourds, parfois mortifères, de la drogue et des devises. Mario Conde est plus que jamais en proie à ses crises de nostalgie, mais tombe aussi amoureux de la rousse et mystérieuse Karina, ingénieur et joueuse de saxophone à l'occasion. L'incipit ayant placé le roman sous le signe de la religion, il n'y a pas lieu de s'étonner que la méditation sur la vie et la mort qu'est aussi le roman lui fasse une certaine place quoique Mario Conde n'y trouve aucune consolation. Mais d'autres pistes s'offrent à la réflexion du "macho-stalinien" qu'est Mario Conde, celles des jeunes "hippies" locaux dits "friquis" qui se contentent de "vivre la vie" comme ils disent en marginaux satisfaits de l'être. Mais pour combien de temps ? C'est un autre visage de la ville qui se révèle ici même si, comme dans le roman précédent, mémoire et solitude des êtres en sont la trame. |
|||
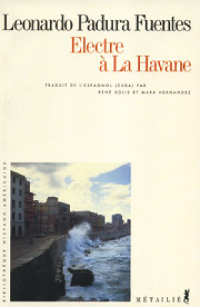 Première de couverture, éd. Métailié, 1998. |
Electre à La HavaneLe troisième volume a été, en fait, le premier traduit en français en 1998 (un an à peine après sa sortie cubaine) par René Solis et Mara Hernandez. L'auteur y apparaît avec son nom de famille complet. Pourquoi avoir changé le titre original, Máscaras ? difficile de répondre ; car le titre cubain pourrait de fait surtitrer l'ensemble des quatre romans, ne s'agit-il pas toujours de lever les masques ? d'exposer à la lumière ce qui ne demande qu'à rester caché ? Et le sujet même du récit est bien celui des masques, des apparences forgées ou non, des mensonges, des préjugés, qu'ils soient issus d'une culture ou d'une autre, celle de Conde (quartier populaire) pour lequel tous les homosexuels sont des êtres répugnants avec lesquels il ne peut être question de se commettre sous peine de mettre en danger sa propre virilité, ou celle de l'idéologie socialiste (furieusement stalinienne) qui a vu, un temps, en eux, le ferment de corruption à l'oeuvre dans la société, d'autant plus sans doute que nombre d'entre eux étaient des artistes.Naturellement s'agissant de masques, il est aussi question de théâtre. L'intrigue est comme toujours policière : la découverte du cadavre d'un jeune homme habillé en femme dans un parc de La Havane. Il s'agit d'un jeune homosexuel, fils d'un diplomate. C'est l'occasion pour Conde de découvrir des réalités que ses préjugés lui interdisaient de soupçonner et de renverser nombre d'apparences, un diplomate rigide, parfait sous tous rapports peut se révéler une crapule sociale autant qu'humaine, et un homme méprisé, condamné socialement, une personne estimable et digne d'amitié en dépit (pour lui, Conde) de ses choix sexuels. En même temps se déroule dans le commissariat central une enquête intérieure qui va mettre à jour de quoi démoraliser un peu plus notre malheureux lieutenant, et le faire songer de plus en plus à démissionner. Conde y renoue avec ses vélléités d'écrivain et pour une fois se met vraiment à écrire. La nouvelle, insérée dans le récit, y est une manière de mise en abîme symbolique puisqu'elle tisse pulsion de vie (Eros) et pulsion de mort (Thanatos). Le roman est aussi, outre cette réflexion sur le mystère des êtres (tous les romans de Padura posent cette question insoluble, qui est quoi ? en sus de l'inévitable qui suis-je ?), un plaidoyer émouvant pour le droit à la liberté de se choisir. Ainsi d'El Rojo, ami de lycée de Conde, quelque peu truand sur les bords, qui cherche dans la religion la paix et la plénitude que la vie ne lui accorde pas, ou du jeune Alexis que l'intransigeance de son père a poussé à la mort, ou du vieux Marqués interdit de théâtre qui ne peut cesser d'écrire, même s'il fait croire le contraire. |
|||
|
|
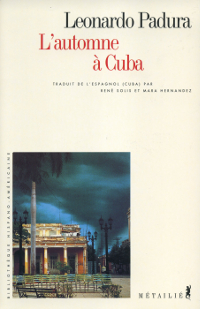 Première de couverture, éd. Métailié, 2000. |
L'Automne à CubaD'abord le titre : ce clin d'oeil à Boris Vian (L'Automne à Pékin) est un peu bécasson, car s'il y a un jeu certain avec la littérature dans ce roman, autant que dans les autres, sinon plus, Boris Vian ne fait pas partie des joueurs à l'encontre de Dashiell Hammet et de son faucon maltais.Le titre original, Paisaje de otoño (Paysage d'automne) était infiniment plus parlant (mais probablement moins vendeur) dans ses multiples dimensions, celle du tableau de Matisse dont il est question dans le récit, celle de La Havane en octobre 1989, en attente d'un cyclone nommé Félix (ironie des mots), celle aussi de la saison mentale des personnages qui les fait passer de leur jeunesse révolue et qu'enterre définitivement un dîner d'anniversaire à un avenir incertain mais adulte puisqu'il va résulter de leurs choix individuels, bons ou mauvais. Le roman est traduit en français par René Solis et Mara Hernandez et publié en 2000. C'est dire que les lecteurs français ont connu la fin de la tétralogie avant de lire ses débuts. L'intrigue : Mario Conde, ulcéré d'avoir vu limoger son patron, le major Rangel, décide enfin de démissionner. C'est compter sans le nouveau patron, le colonel Molina, qui lui propose un marché : résoudre le mystère d'un crime très ennuyeux puisque la victime est un ressortissant américain, même s'il s'agit d'un Cubain exilé. Revenu, officiellement, rendre visite à son père, très malade, Miguel Forcade Mier a été assassiné, puis châtré et jeté à la mer. Que Conde résolve l'affaire en trois jours et sa démission sera acceptée. Il peut, de plus, travailler avec son complice, Manolo, et demander l'aide du major Rangel s'il le souhaite. C'est donc une course contre le temps qui s'engage et qui va, nul ne peut s'en étonner, dévoiler la corruption de certains fonctionnaires, dont le dit Miguel, mais aussi le désenchantement des exilés de Miami, mais encore plonger bien plus profondément dans l'histoire de Cuba, carrefour de la circulation des richesses espagnoles, il y a bien des siècles, un monde de spoliations, de trafics en tous genres. Les histoires et la mémoire, les histoires et l'imagination qui transfigure le quotidien pour le rendre non seulement supportable, mais même heureux parfois, malgré tout. |
| Cuatro estaciones en la
Habana est en fait un
unique roman en quatre longs chapitres, une année (1989) dans la vie
d'un personnage qui se termine le jour de son anniversaire, la soirée
où les six amis (Carlos, Andrès, Conego — le lapin —, El Rojo, Miki et
Mario Conde) avec Tamara, tous condisciples dans leur adolescence,
entrés au lycée, la même année 1972, se retrouvent une dernière fois
pour fêter les 36 ans de Conde. L'unité en est assurée par : 1. Le personnage de Mario Conde qui est bien, selon les voeux de son auteur, qui admire en Salinger "la capacité de créer des personnages qui sont absolument insupportables et en même temps extrêmement attirants" (Le Marathon des mots, Toulouse, juin 2017), souvent désagréable et pourtant considérablement sympathique ; son caractère de "grande gueule", son arrogance, largement compensées par sa fragilité intérieure, une mauvaise foi que sa lucidité contrebalance, et au fur et à mesure du déroulement des récits, ses modifications intérieures, sa sensiblité prenant peu à peu le pas sur son "image", en font un personnage extrêmement attachant. Ce qu'en dit son créateur (Les Masterclasses, France culture) : "Lorsque j’ai créé le personnage de Mario Conde dans les années 1990 pour "Passé Parfait", je lui ai donné beaucoup de missions. Il devait être un policier cubain, qui marche en tant que cubain, et non en tant que policier. Un policier cultivé, très poli, quelqu’un de bien et c’est difficile à trouver partout dans le monde. Il avait la responsabilité d’être mes yeux dans ces romans. Il devait être de ma génération pour comprendre la perspective cubaine, de ce point de vue. Il devait donc me ressembler, avec une histoire personnelle similaire à la mienne." 2. Par le groupe des amis de son quartier, par ceux du commissariat dont le Major Antonio Rangel, fumeur passionné de cigares n'est pas le moindre. De roman en roman, des paroles et des scènes se répètent qui affirment cette profonde unité et complicité du groupe des amis autour de la musique des années 1970, de l'alcool et des repas concoctés par Josefina, comme se répète la question récurrente du Major Rangel qui veut savoir pourquoi Conde est devenu policier, question à laquelle une réponse donnerait sans doute à Conde la clé de ses doutes et de son mal-être. 3. Le cadre : la ville de La Havane dont Mario Conde arpente les rues, regarde l'architecture, le comportement des passants, les transformations qui l'ont affectée depuis ses années d'adolescence. Jon Lee Anderson, dans son article du New Yorker, écrivait : "Like Raymond Chandler's Los Angeles, Padura's Havana is a geography of the human failings." ("Comme le Los Angeles de Raymond Chandler, La Havane de Padura est la géographie des faiblesses humaines" — ou "échecs humains", c'est selon...), et rien n'est plus juste. Mais c'est aussi une ville magique à la sensualité à fleur de peau, des hommes et des femmes qui vivent de tout leur corps, sensibles aux odeurs (bonnes ou mauvaises), aux musiques et aux bruits, à l'âpreté des vents ou à la férocité du soleil, à la douceur des peaux et aux multiples goûts et saveurs, la diversité d'un peuple où se brassent des origines si diverses que c'est en soi un voyage dans le temps et dans l'espace. 4. Par la structure policière des récits : à chaque fois un meurtre, dont il s'agit de dévoiler le mystère, déclenche l'histoire, qui implique, comme il se doit, des motivations personnelles (celles du meurtrier) et un environnement social particulier. Comme dans tous les romans noirs, plus que policiers, le meurtre est le point de départ d'une découverte de ramifications qui vont toujours bien au-delà de l'acte lui-même ; le passé y joue sa partie mais le présent bien plus encore. Regarder une société dans ses dysfonctionnements c'est dévoiler à la fois ses marginalités et son quotidien le plus banal. Par exemple, les difficultés quotidiennes en terme d'approvisionnement (les carnets de rationnement), des transports (bus bondés et inconfortables), de logements (dans une ville qui se dégrade faute d'entretien), etc. 5. La réflexion sur la littérature : avoir fait de Mario Conde un écrivain frustré permet d'interroger sur les fonctions de la littérature (pour l'écrivain comme pour les lecteurs), sur ce qu'elle met en jeu, sur ce qu'elle devrait être. Par exemple, en opposant Miki qui fait de la littérature alimentaire (et pour lui cela signifie remplir le cahier des charges du Parti au pouvoir sans se soucier d'une quelconque interrogation) et Marqués pour qui la littérature est cela seul qui compte, parce que cela seul qui reste et donc la mémoire, des interrogations, des émotions, des peurs, des espoirs, des désillusions ; si la littérature dépasse à ce point l'écrivain alors ce n'est pas cher payer que d'être réduit à l'état de fantôme pour ne pas la trahir, comme Marqués dont Virgilio Piñera (1912-1979) est sans doute le modèle, dramaturge et poète condamné au silence à partir de 1969, en raison en particulier de son homosexualité. 6. Le jeu avec la littérature justement. On n'en finirait pas de citer les auteurs (Padura le fait lui-même d'ailleurs à l'orée d'Electre à La Havane) avec lesquels Padura joue, de Hemingway à Salinger, en passant par José Maria de Heredia (le Cubain, pas le Français) ou Julio Cortázar, sans oublier bien sûr les écrivains et poètes cubains moins connus (voire ignorés) des lecteurs francophones. 7. Le sentiment de la perte. De Mario Conde, son auteur dit qu'il est une "métaphore". Et certes, il l'est, dans la mesure où son parcours individuel est aussi un parcours collectif, de l'enthousiasme et des espoirs des premières années de la Révolution cubaine, à la fatigue, au découragement devant les difficultés qui ne sont pas surmontées, ou du moins si lentement, qu'elles paraissent se répéter, être toujours à réaffronter de nouveau. Mais davantage encore, il me semble, il est la métaphore de l'être humain tout court. Point n'est besoin d'être Cubain pour éprouver le sentiment que la vie nous a trahis, que les rêves de jeunesse se sont le plus souvent effondrés sous les nécessités les plus diverses, pour traîner comme des boulets des regrets de tous ordres, pour se réfugier dans un passé que la mémoire fait volontiers parfait (tant de récits ne célèbrent-ils pas l'enfance et l'adolescence ?) au détriment d'un présent trop difficile à construire. La vie humaine est une succession de pertes jusqu'à la dernière, celle où l'on se perd soi-même. Ce que construit Padura dans ces quatre romans pourraient se rapprocher sans peine de cette réflexion du héros d'Hôtel Savoy de Joseph Roth (1924) :
Mais pour être tout à fait équitable, il faut aussi souligner que cette vision, à première vue triste, de la condition humaine, n'est chez Padura jamais désespérée. Les hommes peuvent changer, Mario Conde en est l'exemple. Au cours de cette année 1989, il change, il se libère d'un certain nombre de ses préjugés, accepte finalement de courir le risque de se mettre à écrire. Les hommes peuvent s'entraider, s'aimer, se réconforter, vivre et changer sinon le monde, eux-mêmes. Et rendre la vie plus vivable. La littérature est là pour ça, inventer d'autres manières de regarder et de sentir, exalter la beauté où qu'elle se trouve, y compris dans une ville en souffrance. |
Pour écouter l'écrivain : France-Inter, L'humeur vagabonde, 13 octobre 2014, après la sortie en France de son roman Hérétiques. France culture, Les Master classes, Arnaud Laporte. Emission dans laquelle Padura revient sur sa formation.
Pour le regarder et l'écouter : sur Havana-club (attention, les sous-titres sont en anglais) et découvrir aussi La Havane.A lire : un article de Néstor Ponce, "Mario Conde : Vie d’un Cubain à La Havane" dans Cahiers d'études romanes, 2006 |