Voyage
au bout de la nuit, Céline, 1932
|
||
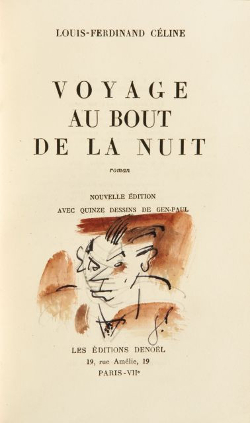 Première de couverture de l'édition Denoël de 1942. Elle est illustrée par Gen-Paul (1895-1975). |
Voyage au bout de la nuit
est le premier roman de Céline, pseudonyme du docteur Louis-Ferdinand
Destouches qui a emprunté le prénom de sa grand-mère maternelle, morte
à la fin de 1904. Etonnant premier roman, une vraie bombe dans
l'univers littéraire de l'époque. S'il n'obtient pas le prix Goncourt
que tout semblait lui promettre, le prix Renaudot lui est remis le même
7 décembre 1932 où le prix Goncourt est octroyé à un écrivain sorti
des mémoires, Guy Mazeline. Sur l'auteur, il n'y aurait que des choses désagréables à dire, aussi nous en abstiendrons-nous. Mais il faut quand même savoir qu'il est né en 1894 et mort en 1961. Qu'après ce remarquable premier roman, il s'est empêtré dans une idéologie d'extrême-droite, extrêmement nauséeuse, antisémite virulent, mauvais coucheur, il collabore avec l'occupant et prend la fuite en 1944 pour aller au Danemark. Il sera jugé, condamné, en 1950, puis amnistié en 1951. Il n'y a rien à savoir de plus, et c'est déjà trop. Ecrivain pour le moins clivant, certains jugent, comme lui-même, qu'il n'est qu'un styliste et que toutes ses oeuvres relèvent d'un travail créatif, celui de transcrire au plus près l'émotion. D'autres se bornent à admirer ce premier livre, s'interrogent déjà un peu plus sur le suivant, Mort à crédit (1936) et abandonnent le reste à la curiosité historique. Avant d'entrer dans le roman proprement dit, le lecteur est confronté à un titre énigmatique, comme la dédicace à une inconnue, à une épigraphe qui l'est à peine moins, et à une note liminaire. En somme, une quadruple mise en garde. Et pour une nouvelle édition, en 1949, à une préface qui prétend véhémentement que, sans la nécessité de gagner sa vie, il supprimerait tout. Le titre : il s'inscrit dans la métaphore essentielle de l'homo viator. Considérer la vie comme un voyage et l'humain comme un voyageur en transit entre sa naissance et sa mort est de si longue date une métaphore usuelle qu'elle en a des saveurs de cliché. Toutefois, l'expression "au bout de la nuit" connote ce parcours comme semé d'embûches, de difficultés, mais orienté vers un espoir puisqu'au bout de la nuit, selon l'expérience commune, il y a le jour. Le lecteur peut alors se souvenir de ce vers de Hugo, "Chaque homme dans sa nuit s'en va vers sa lumière" ("Ecrit en 1846", Contemplations, II, V, 3) et il aurait à la fois tort et raison, car au bout du voyage il y a bien le livre qu'il va se mettre à lire, qui donne le jour à ce que contient la nuit. Le roman ainsi titré est dédié "A Elisabeth Craig". Cette jeune femme est encore, pour quelques mois, la compagne de l'écrivain. C'est une jeune danseuse étasunienne (1902-1989), connue à Genève, en 1926. Elle se séparera de Céline en 1933. D'être ainsi dédié à une jeune femme, le roman gagne une sorte de vitalité car une dédicace est toujours un hommage, une marque d'affection voire d'amour. Elle renforce aussi le caractère littéraire du livre à venir, car le lecteur ne manquera pas de s'étonner en le lisant de constater que les personnages féminins du roman frisent souvent la caricature. Mais cette impression d'optimisme est vite battue en brêche par l'épigraphe, un quatrain supposé appartenir à une chanson des Gardes suisses, que l'écrivain date de 1793. Les quatre vers reprennent la métaphore, "Notre vie est un voyage", et précisent la nuit dont il s'agit : c'est la vie elle-même "Hiver" et "Nuit" sous un Ciel vide de repère, donc impropre à l'orientation que ce soit dans le sens physique où guident les étoiles, ou au sens métaphysique que pourrait suggérer la majuscule qui en ferait une métonymie de Dieu. La date de 1793 renforce cette négativité puisque c'est, dans la Révolution française, l'année de la Terreur (janvier, exécution du roi ; août : décret de la levée en masse — tous les jeunes gens entre 18 et 25 ans sont mobilisés ; septembre : massacres dans les prisons parisiennes). |
|||
| Enfin, le texte
liminaire, dans sa brièveté, jouant avec les
traditionnels avertissements à l'orée d'un récit avisant qu'il n'y faut
reconnaître personne, donne au terme "voyage", un sens que les jeunes
gens de la seconde moitié du XXe siècle
ne renieraient pas, à la fois
déplacement dans l'espace réel et fantasmagories : "Notre voyage à nous
est entièrement imaginaire" et d'ajouter "Hommes, bêtes, villes et
choses, tout est imaginé". Le lecteur est donc mis en garde contre la
tentation biographique que le "je" narrateur a, en général, tendance à
susciter. C'est "un roman, rien qu'une histoire
fictive. Littré le dit qui ne se
trompe jamais", cette pirouette finale qui s'en remet à une
autorité pourrait incliner à en douter. La note se termine sur cette
formule énigmatique "C'est de l'autre côté de la vie", autre façon de
suggérer que le lecteur entre en littérature et qu'il ne doit pas
s'attendre à autre chose. |
||||
Construction du récitEntre l'incipit "Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit. Rien. C'est Arthur Ganate qui m'a fait parler" et l'explicit où le sifflet d'un remorqueur appelle "vers lui toutes les péniches du fleuve toutes, et la ville entière, et le ciel et la campagne, et nous, tout qu'il emmenait, la Seine aussi, tout, qu'on n'en parle plus", passage du silence à la parole et de la parole au silence, se déroule un récit à la première personne qui a, parfois, des allures de logorrhée et qui n'en est pas moins strictement construit ; le tout se déploie sur 45 chapitres de longueurs inégales, non titrés et non numérotés.Dès sa parution, le roman a déconcerté, en témoigne le jeune Lévi-Strauss qui écrit dans L'Etudiant socialiste, en janvier 1933 : "On peut hésiter sur le nom à donner à cet énorme ouvrage de six cents pages, d'une narration si serrée et continue qu'on se le figurerait sans peine écrit en un seul paragraphe : roman ? autobiographie ? récit ? feuilleton ?.." A première vue, il semble, de fait, agglutiner plusieurs romans en un seul, enchaînant événements et lieux différents, la guerre (témoignage ?), l'Afrique, l'Amérique (aventure ?), la banlieue parisienne (roman réaliste, voire naturaliste, compte tenue de l'importance des corps ?) où le personnage-narrateur se retrouve soldat sur le front, blessé à l'arrière, administrateur d'un comptoir africain au milieu du rien, ouvrier dans les usines Ford de Detroit, médecin dans la banlieue pauvre de Paris. Toutefois, dans ce flux de parole ininterrompu, il est possible de voir deux grandes parties dans l'ensemble, une première toute entière sous le signe du déplacement qui confine à l'errance (1-19), une seconde plus sédentaire (20-45) au sens où les déplacements se font sur un territoire réduit, les banlieues parsiennes, avec une brève incursion à Toulouse. |
||||
| Première partie : l'errance La première partie pourrait être mise sous le signe du roman picaresque : un personnage, jeune (il a 20 ans), démuni, seul, doit affronter un monde hostile et s'y trouver une place. Les expériences vécues ici par le personnage-narrateur, dont le lecteur apprend le nom au chap. 4, Bardamu, sont extrêmes. L'auteur les a puisées dans sa propre histoire mais, contrairement à ce qu'il a affirmé, avec violence, toute sa vie, les livres ont aussi fourni un apport non négligeable, qu'il lui arivait, parfois, de reconnaître aussi, n'étant jamais à une contradiction près. Refus de l'imprimé qu'il manifeste, par exemple, dans un entretien avec Albert Paraz, en septembre 1949, "Si je vais «m'inspirer» comme on dit ce n'est certainement pas dans les lectures ! Choses mortes ! mais dans des éléments vivants." (c'est lui qui souligne, cité par André Derval, Magazine littéraire, octobre 1991) Bardamu naît dans la guerre et par la guerre. Et certes l'auteur en a fait l'expérience, mais il a été blessé en octobre 1914, évacué vers l'arrière et envoyé ensuite à Londres, employé du consulat de France avant d'être réformé en décembre 1915. C'est dire que les pages spectaculaires des chapitres 1 à 4 doivent beaucoup à d'autres sources que l'expérience personnelle. Parmi celles-ci, Le Feu de Barbusse a sans doute joué un grand rôle. Pensons, en particulier, au souci de Barbusse de rendre au plus près l'expérience de l'horreur (en 1916, disons-le, c'était plus osé qu'en 1933) et la parole des gens ordinaires qu'étaient les fantassins avec lesquels il avait combattu. D'emblée Bardamu (dont le nom est déjà toute une histoire puisque sa première syllabe est la même que celle de Barbusse, que les deux premières syllabes font penser au terme d'argot militaire "barda", équipement porté sur le dos, emprunté à l'arabe, et la troisième "mu" invite à le regarder comme une sorte de marionnette poussée dans le dos, obligé d'avancer malgré lui), Bardamu donc est une victime (du monde et de lui-même), victime d'un élan patriotique incongru qui le fait s'engager et victime promise à l'abattoir qui n'a plus qu'un désir, fuir et sauver sa peau. Par moments, le lecteur entend aussi des échos de la "boucherie héroïque" du Candide de Voltaire, tellement d'ailleurs qu'une vraie scène de boucherie est insérée à la fin du 2e chapitre. Comme les personnages de Barbusse, il découvre vite ce qu'il n'appelle pas "lutte des classes", et pour cause, mais la division du monde entre les nantis et les autres, dont il fait partie. Une nuit de patrouille, il rencontre celui qui apparaît à la fois comme son double et son ombre : Léon Robinson, lui aussi en proie à un irrépressible désir de fuite ; Robinson aura ainsi une présence furtive à tous les moments importants de la vie de Bardamu avant d'occuper une place centrale dans la 2e partie. L'épisode du Front se termine sur la blessure. Les chapitres suivants vont entraîner Bardamu, à l'arrière, d'hôpitaux en hôpitaux, après que sa blessure soignée, il tombe dans une dépression sévère à la limite de la folie, la peur envahissant totalement le personnage. |
Cliquer sur l'image pour le
tableau complet
Panneau central du triptyque La Guerre, 1929-32. Otto Dix (1891-1969). Galerie Neue Meister, Dresden (Allemagne) |
|||
| Les chapitres 5 à 9
fournissent ainsi non seulement une galerie de
portraits des "profiteurs" de guerre (qui inclut les femmes) mais aussi
une satire, souvent féroce, de la médecine et de la science, dont le
docteur "aux beaux yeux", Bestombes, au nom prometteur, est
emblématique. Mis à la porte des hôpitaux, Bardamu veut partir, "Plus que ce sera loin, mieux ça vaudra !", et donc ce sera l'Afrique (10 à 14). Une Afrique fantasmée, on s'en doute, même si, de fait, l'auteur a connu le Cameroun où il a été "surveillant de plantation" entre juin 1916 et avril 1917 quand il est rapatrié pour raisons sanitaires, où il a aussi voyagé durant à peu près trois mois en 1926, en mission (avec 16 collègues médecins) pour la SDN. Bardamu s'embarque sur un navire qui se transforme vite en nef des fous, il s'évadera de ce monde étouffant par la maladie une fois encore, vendu et transformé en galérien à bord d'une galère tout droit sortie d'un somptueux délire. Le parcours de Bardamu en Afrique n'est pas sans rappeler celui de Marlow dans Au coeur des ténèbres de Conrad (traduit en français en 1925) avec la remontée du fleuve vers un comptoir où il s'agit de remplacer un employé indélicat et sans doute dangereux qui, on s'en doute, se révèlera être Robinson, à peine entrevu que déjà disparu. Cet épisode africain est à la fois sous le signe de la satire et du délire qui met à mal le colonialisme, un monde de cruautés imbéciles autant qu'inutiles. Un univers, qui fait corps avec la nuit, dans lequel les personnages rencontrés, les colonisateurs, administrateurs, militaires, commerçants, pillent à tout-va, s'alcoolisent sans retenue, sont dévorés par toutes sortes de maladies plus répugnantes les unes que les autres. Bardamu entre dans cet univers délirant sur un bateau dont les passagers veulent l'éliminer et en sort en ramant dans une galère. Plongée dans le passé, plongée dans l'inconscient. A l'opposé de cet environnement foisonnant, extravagant, débordant, l'aventure américaine (l'Amérique, 5-19) sera verticale, lisse, mais tout aussi destructrice, comme elle apparaît déjà depuis le bateau aux galériens ébahis "Figurez-vous qu'elle était debout leur ville, absolument droite". Si tout est trop propre, au point d'en être effrayant, les sous-sols ne le sont guère, les usines déshumanisantes encore moins. |
 Illustration de Clément Serveau (1886-1972), gravure sur bois, éd. Ferenczi et fils, Le Livre moderne illustré, 1935. |
|||
| Là
encore se mêlent l'expérience de l'écrivain qui fait un voyage aux
Etats-Unis pour la SDN (mai-août 1925) où il visite les usines Ford de
Detroit, et probablement aussi les histoires d'Elisabeth Craig et
de sa famille, sans oublier le cinéma. Comme pour l'Afrique, le récit
rétrospectif de Bardamu travaille essentiellement les clichés à la fois
pour les infirmer (l'efficacité et la modernité, épisode du "comptage
des puces") et pour les confirmer
(le "dieu dollar", "tout pour le commerce"), malgré la beauté, la
gentillesse et la générosité de Molly, Bardamu reprend sa fuite en
avant, laissant derrière lui, cette fois, Robinson retrouvé à Detroit. Seconde partie : médecin des pauvres. Du chapitre 20 au chapitre 45 se déroule ce qui ressemble davantage à un roman avec intrigue et personnages secondaires. Bardamu est devenu médecin, transformation sur laquelle le narrateur ne s'étend guère (à peine un paragraphe conclu par cette phrase "Elle est bien défendue la Science, je vous le dis, la Faculté c'est une armoire bien fermée. Des pots en masse, peu de confiture.") Il s'installe en banlieue, à la Garenne-Rancy, dont le nom est prometteur de bien des misères encore. Dans cet univers au ciel aussi fuligineux que celui de Detroit, il ne fera pas davantage fortune que sur les terres africaines ou américaines. La vie quotidienne des très pauvres confrontés à la maladie, à la bêtise doublée ou non de méchanceté, la mort guette partout et toujours, les enfants comme les vieux, les femmes dans leur sexualité comme les hommes dans la violence. Après avoir découvert la vérité du monde dans la guerre ("une envie chez l'homme latente de tuer et d'être tué"), Bardamu a pu constater à ses dépens qu'elle est généralisable, valide en tous lieux du plus éloigné de la "civilisation", la forêt africaine, au plus sophistiqué, les rues des villes américaines qui semblent s'offrir en image de l'avenir. C'est bien un roman "noir" qui se donne ainsi au lecteur. Et pourtant, ce qui pourrait paraître désespérant, ne l'est pas, à l'encontre de ce que grand nombre de critiques ont formulé lors de sa parution, avec des mots souvent fort brutaux, le critique du Figaro parlait de "l'oeuvre épouvantable de M. Céline" (10 décembre 1932). Comment expliquer ce paradoxe ? Par plusieurs éléments qui, en se combinant, font imploser la volonté déclarée de fouiller les plaies sociales, que tout un chacun découvre dès la première lecture : la guerre, le colonialisme, le travail abrutissant, la misère sous toutes ses formes. |
 |
|||
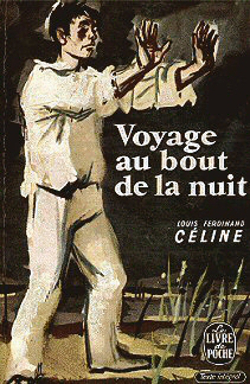 Livre de poche, 1956, couverture de Lucien Fontanarosa (1912-1975) |
L'invention du narrateur et de son
langage Céline, tout au moins lors de la parution de son livre, crédite Eugène Dabit comme source d'inspiration. En 1934, dans la revue Europe, Dabit jugeait qu'il était de nouveau urgent que les anciens combattants "se remettent dans la peau de l'être misérable qu'ils furent et retrouvent leurs vraies colères, leurs haines". Affirmation qui éclaire assez le point de vue choisi par Céline avant même que Dabit le formule. Céline fait alors le choix de confier la narration à son personnage (ce n'était pas le cas dans les premières versions), le roman sera un récit à la première personne, l'expression donc d'une subjectivité, mise en place dès l'incipit par la définition de la "race" constituée de "miteux" et la métaphore de la galère (qui renvoie tout autant à Pascal "vous êtes embarqués" qu'à Hugo qui en a beaucoup usé) que n'altère ou ne tempère aucun autre point de vue. C'est, par ailleurs, une subjectivité qui se manifeste dans le regard porté sur le monde où se confondent ce qui pourrait appartenir à un réel concret et l'univers des fantasmes propres au personnage, par exemple la danse des spectres sur Montmartre. Si le lecteur se laisse bien entraîner à épouser les émotions, les sentiments de Bardamu, il s'en écarte aussi parfois, et cette distance permet de réévaluer expériences et jugements, car souvent ce narrateur apparaît comme un pauvre type, parfois comme un roublard, peu soucieux d'autrui, férocement égoïste pour l'essentiel, en même temps qu'habité par une colère immense, que rien ne paraît pouvoir éteindre. Le langage de Bardamu est dans le même mouvement motif d'adhésion et de distanciation. Fausse langue orale qui mêle une syntaxe le plus souvent empruntée à l'oral familier, mais ne refuse pas les jeux les plus sophistiqués avec la concordance des temps, tous les niveaux de lexique, de l'argot au jargon scientifique (ici le vocabulaire médical), qui joue de la prononciation parisienne (voye, soye pour vois et sois), elle est à la fois entraînante tant elle paraît naturelle et spontanée, et si intrigante, parfois, qu'elle suspend la crédulité du lecteur. Exemple "Il me fit sans que je l'en priasse, sur Grappa, un portrait express au caca fumant", les rythmes, l'incongruité du "caca" (terme emprunté au vocabulaire enfantin) et de son adjectif (qui n'a rien d'enfantin) avec le passé simple et l'imparfait du subjonctif, l'utilisation erronée de la préposition" sur" où l'on attendrait "de", tout arrête et interroge. Ce langage, par ailleurs, dans sa fausse spontanéité, donne au propos fût-il le plus banal, de l'ordre du lieu commun, une puissance inhabituelle en cessant de paraître issu de considérations abstraites mais le fruit, semble-t-il, d'une expérience vécue dans la chair, ce que renforce le point de vue médical fouillant l'intérieur des corps. Ce même langage est aussi source de comique, à commencer par l'invention des patronymes et des toponymes. Nous avons noté le nom du narrateur-personnage, Bardamu ou celui de la ville où il exerce, dans la banlieue parisienne, la Garenne-Rancy qui contient à la fois un passé campagnard (Garenne) et sa décomposition (ranci de rance, à la fois mauvaise odeur et mauvais goût). En règle générale, ces inventions vont dans le sens de la dénonciation, quand ce n'est pas la condamnation, ainsi du nom de la Compagnie qui le transporte en Afrique, "Compagnie des Corsaires Réunis", CCR, qui fait inévitablement penser à la Compagnie des Chargeurs réunis qui opérait vraiment sur ces lignes. Le terme "corsaire" renvoyant au pillage, au vol, aux exactions, tout comme d'ailleurs l'entreprise employant Bardamu en Afrique qui s'appelle "Pordurière" où il ne faut guère d'effort pour lire "ordure". |
|||
| D'autres
termes vont aussi
dans le sens de la dévaloristion, parfois dénotatifs comme la famille
Henrouille, qui s'est entièrement décomposée dans sa folie des
économies pour devenir propriétaire d'un pavillon et qui a perdu tout
sens humain, plus aucun lien de famille ne résistant à ce caustique ;
parfois plus ludique et plus
grossier, comme Roger Puta, bijoutier, comme "l'amiral Bragueton" nom
du bateau qui le conduit en Afrique, ou "San Tapeta" capitale du Rio
del Rio ou encore "l'Infanta Combitta" qui le mène en Amérique ou
encore le cinéma, où il est engagé comme figurant pour les revues
d'entracte, "le Tarapout". En réalité, il faut prêter attention à tous ces mots qui aident à glisser le romanesque dans la satire, mêlant l'horrible au grotesque dans une sarabande qui pour être infernale n'en est pas moins joyeuse. Mais surtout ce qui reste du roman, une fois lu, c'est un profond sentiment de pitié. En 1959, Céline disait au micro de Francine Bloch, qui l'enregistrait pour la Phonotèque nationale, que Le Voyage..."était un livre communisant" et d'ajouter "les communistes n'ont rien compris non plus", remarque qui nous semble profondément juste. Le roman provoque chez le lecteur un sentiment de révolte, non contre les incongruités de son auteur (comme disait le critique du Figaro, en 1933), mais contre une société qui maltraite à ce point les humains. Le pathétique réfléchi Jean-François Marmontel (1723-1799) distinguait deux formes de pathétique, le pathétique direct qui consiste à manifester ou à représenter l'émotion même que l'on veut susciter et le pathétique réfléchi par lequel l'orateur ou le dramaturge provoque une émotion chez son public sans se servir lui-même des signes de cette émotion. Ce pathétique repose sur le sous-entendu mettant en opposition ce qui est raconté et ce qui est suggéré. Le Voyage au bout de la nuit, que l'auteur l'ait voulu ou non, relève de cette seconde forme. Le narrateur ne s'attendrit sur rien, sauf sur lui-même, à l'occasion ; la plupart du temps, quand la situation exigerait une intervention, il fuit ; mais il raconte. L'émotion que suscite le récit provient justement de l'absence d'émotion, des protagonistes comme du narrateur, qui ne laisse d'autre choix au lecteur que de s'insurger à leur place, par exemple à la fin de la séquence guerre-hôpital, la souffrance et la mort de la mère qui a perdu son fils paraissent à Voireuse et Bardamu de peu d'importance face à l'argent perdu dont ils espéraient être gratifiés, c'est dans ce décalage que s'inscrivent à la fois la pitié et la condamnation. De même que le personnage de la mère du narrateur, inquiète de tout, résignée à tout, que son fils traite avec désinvolture et souvent du mépris, n'en est pas moins le portrait émouvant de ceux qui, comme elle, croyaient "que les petites gens de sa sorte étaient faits pour souffrir de tout" ; tous les pauvres qui savaient qu'il "faut rester à sa place", capables de dire "ce n'est pas pour nous", ceux à qui la société ne permet même pas le rêve. Mère emblématique de toutes les mères affectueuses et démunies (et pas si loin de la tante de Bébert), ce qu'elles ne sont pas toutes, puisque certaines sont des bourreaux comme celle qui préfère voir mourir sa fille d'un avortement mal fait plutôt que d'encourir la honte de l'hôpital, ou celle qui, de concert avec son mari, martyrise leur petite fille (épisode très bref et très dense, d'autant plus insupportable qu'il condense le martyre de Louisette que raconte bien plus longuement et en pathétique direct, Jules Vallès dans L'Enfant). Les enfants aussi sont des victimes, de la maladie d'abord (la nièce d'Alcide, le colonial), de la malnutrition, des conditions générales de la vie dans les banlieues pauvres et polluées, de la brutalité des adultes aussi, même lorsqu'ils sont aimants. La tante de Bébert aime son neveu mais ne sait lui parler qu'avec brutalité, le menaçant constamment du martinet (qui fut longtemps une réalité dans l'éducation des enfants et pas seulement chez les pauvres). Le narrateur "parle" de l'intérieur toute la misère accumulée sur ceux qui produisent le profit des exploiteurs, ceux qui vont mourir pour une guerre à laquelle ils ne comprennent rien, ceux que les grosses entreprises via des colons imbus d'eux-mêmes et de leur supériorité (mais "victimes" eux aussi sans le percevoir) pressurent sans mesure et l'épisode de la famille de ramasseurs de caoutchouc suffit pour, en quelques lignes, en dévoiler le scandale, les ouvriers tout aussi maltraités par les usines modernes de Detroit que par celles de Rancy. Il s'agit bien de remplir un programme : "On ne sera tranquille que lorsque tout aura été dit, une bonne fois pour toutes, alors enfin on fera silence et on aura plus peur de se taire. Ça y sera." (Pléiade, 1992, p. 327) Et, de temps à autre, dans ce monde que domine la nuit (nuit extérieure mais aussi nuit intérieure) où le lecteur en vient à se demander ce qu'il peut bien rester d'humain, apparaissent des personnages qui offrent une légère respiration, la bonté coincée de la mère, le désespoir d'une autre qui meurt d'avoir perdu son fils (toute riche qu'elle est), le dévouement d'Alcide le colonial pour sa nièce orpheline, la générosité de Molly, prostituée de Detroit, celle des habitants de la péniche près de Toulouse, ou même l'énergie vitale de la vieille Henrouille (elle a 80 ans est-il précisé) avec son regard qui danse "bien guilleret", "Ce regard allègre animait tout alentour, dans l'ombre d'une joie jeunette" et sa manière de parler en faisant "sautiller, phrases et sentences, caracoler et tout..." et cette conclusion du portrait : "L'âge l'avait recouverte comme un vieil arbre frémissant, de rameaux allègres." De bout en bout, Le Voyage au bout de la nuit est un roman étonnant. L'alacrité de la langue inventée par Céline, et qu'il ne cessera au cours de son existence de vanter, intensifie la portée de cette longue méditation sur les bas-fonds de l'âme dont il se dira longtemps redevable à Freud. Les Essais de psychanalyse, traduits par Jankélévitch et publiés en 1927, contenaient Au-delà du principe de plaisir et Considérations actuelles sur la guerre et la mort, dont on retrouve de nombreuses traces dans le roman, par exemple, cette formule du narrateur, "De nos jours, faire le «La Bruyère» c'est pas commode. Tout l'inconscient se débine devant vous dès qu'on s'approche". Bardamu et Robinson, l'un passif, l'autre actif, il est celui qui passe à l'acte, qui donne et cherche et trouve la mort, sont d'une certaine manière la version consciente et inconsciente d'un même personnage. Ce qui est curieux, dans cette aventure, c'est que le roman n'a pas exorcisé son auteur qui expliquait le comportement agressif des passagers de "l'Amiral Bragueton" avec ces mots "Quand la haine des hommes ne comporte aucun risque, leur bêtise est vite convaincue, les motifs viennent tout seuls." Quand il écrit sa préface en 1949, il semble avoir conscience d'avoir écrit un chef-d'oeuvre (il parle de "don" à son propos), en même temps qu'une oeuvre qui le condamne. Pas vraiment pour les raisons qu'il avance, mais parce que l'humanité de son roman se dresse, accusatrice, contre celui qui s'est trahi lui-même en devenant, à son tour, un des passagers de "L'Amiral Bragueton". |
||||
A découvrir : la banlieue parisienne, en l'occurence la Garenne-Clichy, plus souvent appelée Clichy tout court, en particulier, l'histoire du boulevard Victor Hugo. A lire : un exemple de la réception critique en 1932, André Rousseaux, Le Figaro, 10 décembre 1932. A écouter : une présentation croisée du roman par Mathias Enard, Yves Pagès, Pauline Hachette, Alexandre Civico dans l'émission "La culture change le monde", mardi 9 août 2022.
Concordance des temps, France culture, "A propos de Céline, la
responsabilité morale de l'écrivain sous la IIIe République", 19 février 2011, avec Gisèle Sapiro.
|